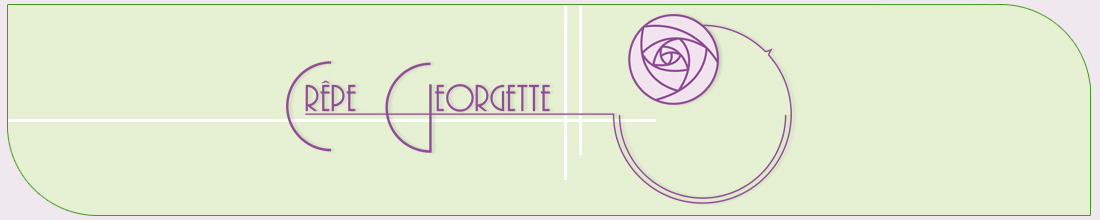Il y a deux ans aujourd’hui ma mère est morte. J’ai documenté ici même mon deuil y a deux ans, avant tout pour moi, parce qu’écrire et publier m’a fait retrouver le sommeil, mais j’avais constaté avec étonnement l’infini nombre de réactions positives face à ce texte.
Pendant une quinzaine d’années, je n’ai pas pu traverser tranquillement les 15 jours précédant le jour anniversaire du suicide de mon père. Je les passais dans une sorte d’hébétude, à coups de lexomyl et j’émergeais le 15 mai dans une gueule de bois mémorable. Je ne savais plus année après année d’ailleurs si j’étais réellement triste ou si je créais cette tristesse en ayant peur de la ressentir ; foncer dans le mur en ayant peur de l’affronter au fond.
Il y a quelques temps, je me suis étonnée sur twitter de voir des gens parler de leurs proches disparus en soulignant tout ce qui les leur rappelait. Je sais qu’il n’y a pas un deuil similaire mais il me perturbait profondément de voir que je ne pensais réellement jamais à ma mère. Je l’ai gommée de ma vie c’est comme si elle n’avait jamais existé. J'ai effacé son numéro de téléphone dans la demi-heure qui a suivi son décès par exemple. Je me demandais, comme souvent, si j’étais « bien normale » (même si on sait que cette expression a gagné plusieurs prix dans la catégorie "expression la plus con de l’année") .
En vrai je mens un peu. Le rappel que ma mère est morte, que je suis désormais orpheline (je pouffe un peu en écrivant ça, une orpheline c’est pour moi une petite fille dans un pensionnat tenu par une dame très méchante mais non c’est juste quelqu’un qui a perdu ses deux parents) me revient parfois comme un brutal coup de rasoir dans le corps. Les cerises que je cueille et qui me rappellent une discussion avec ma mère, un produit encaustique que j’utilise et dont ma mère faisait une consommation effrénée, un chignon blond dans le métro, quelqu’un qui se plaint de sa mère et moi qui aimerais me plaindre de la mienne. A chaque fois la douleur revient, brutale inattendue, comme une coup de couteau et d’autant plus violemment qu’on ne s’y attend pas, parce que ce n’est pas systématique. Ce n’est pas à chaque cerise que je pense à ma mère sinon la solution serait simple ; je les bannirais de ma vie.
Je n’ai pas pu me me préparer à la mort de mon père ; tout à l’heure j’en ai parlé comme d’un assassinat. Mon père a assassiné mon père ai-je dit. L’image n’est pas fausse dans mon esprit ; lui avait probablement, possiblement prémédité son geste et j’en veux autant à l’auteur que la victime me manque même si c’est la même personne. Ce qu’on pleure dans un deuil, au-delà de l’absence ce sont les regrets, ou on fantasme plutôt ce qu’aurait été notre relation si la personne avait vécu plus longtemps. Et logiquement plus la personne a longtemps été absente de notre vie, plus elle en a raté. J’étais perdue à 24 ans quand mon père est mort, entre alcool et drogues, et fêtes, et dangers. J’aurais aimé qu’il voit que tout compte fait, ça va. Je me leurre en me disant que peut-être il aurait été fier de moi. Parfois je me dis que cela a du bon qu’il soit mort car ça m’évite d’innombrables engueulades douloureuses sur le féminisme avec lui.
J’en avais presque le double à la mort de ma mère mais il reste toujours des regrets ; ai-je été une assez bonne fille ? (non) A-t-on pu régler nos comptes comme dans ces téléfilms américains qui m’obsèdent, où une américaine brushingée au teint de rose se meurt élégamment entouré de ses enfants à qui elle prodigue amours et conseils qui leur serviront toute leur vie ? Non nous n’avons rien pu régler et ma mère est partie avec mes regrets, mes colères et mes questions.
J’aimerais vous dire qu’on va mieux après deux ans et le fait est que c’est vrai. On va mieux. Mais – tout en n'étant pas con au point d’attribuer des maladies physiques au chagrin – je ne peux m’empêcher de penser que les deux entorses majeures que j’ai eues cette année ont quelque chose à voir avec tout ça. Un charlatan à la con dirait qu’une rupture du ligament est symptomatique d’une scission entre deux êtres et d’un deuil. Je vous dirais simplement que j’ai tellement voulu m’épuiser pour éviter de penser que mon corps s’est tout bonnement épuisé et a dit stop, juste d’ailleurs avant une fracture de fatigue. Faites attention à vous si vous êtes dans ce cas là (si vous êtes en mesure de le faire bien sûr). C’est marrant je me suis prise une semi shitstorm sur twitter en parlant du sport comme d’une addiction dangereuse ; et pourtant pour avoir tenté de faire un deuil en faisant beaucoup de sport, je peux vous dire que cela n’est pas l’idée du siècle, vraiment. J’aurais presque envie de vous dire, si vous avez/devez affronter un deuil de voir un psy, mais ca serait peut-être malvenu puisque j’ai été incapable de le faire.
Depuis 15 jours donc, j’allais mal. Sans comprendre pourquoi. Il faut dire qu’entre le covid, le chômage, ma perception du temps est un peu altérée. Et hier, je me suis retrouvée sidérée de douleur dans la rue et j’ai regardé la date, consulté l’acte de décès de ma mère (oui je n’arrive pas à retenir la date, voir l’année de sa mort) et puis j’ai compris, cette tristesse diffuse, ce malaise, cette agressivité permanente. J’étais pile deux ans après les jours les plus difficiles de ma vie et je les avais presque oubliés. Alors que j'avais pensé des années à me préparer aux 15 jours précédant l'anniversaire de la mort de mon père, j'avais presque oublié celui de ma mère jusqu'à ce qu'il me rattrape de la façon la plus brutale qui soit, en me pliant littéralement de douleur et de chagrin en plein Paris.
J’ai alors fait ce que je fais toujours ; pris une décision, radicale, impulsive, et en 1 heure j’avais trouvé un tatoueur qui m’a tatoué les doigts. Ma mère aurait tellement détesté ca. Cela 20 ans que je veux le faire et j’hésitais car rationnellement pour trouver un emploi ce n’est pas l'idée du siècle. Et sans doute que c'est convenu, sans doute que c'est un peu pathétique, sans doute plein de choses mais la douleur physique ressentie m'a calmée, les mots gravés illustrent à merveille la relation que j'entretiens avec ma mère et ils sont suffisamment visibles pour l'instant pour que je ne les oublie pas. C’est rigolo parce qu’une personne sur twitter s’est permise de me dire que « les tatouages sur les doigts ça s’efface » et en vrai, vu qu’ils ont symbolisé mon infinie tristesse et ma rage si un jour ils s’effacent, j’y verrai quelque chose de pas forcément négatif.
Je ne sais pas où ce texte va – ni s’il doit aller quelque part – mais la première fois il n’allait pas plus droit et certains d’entre vous l’avaient trouvé utile, j’espère qu’il en sera de même ici et sinon bah tant pis… quelques traces de plus sur Internet.
Prenez soin de vous.
C’est assez étrange que je choisisse de vous parler d’un des sujets qui est le plus traumatique pour moi, le suicide, à un moment où je suis extrêmement fragile. A ce sujet je fais un bref aparté sur les trigger warning. Je suis toujours étonnée (et le terme n’implique aucun espèce de jugement) que certain-e-s les jugent utiles pour eux-mêmes. Le tw suicide, a, a contrario, un effet extrêmement négatif pour moi. Je m’explique.
Mon père s’est suicidé en 1998. Depuis cette date, je lutte donc pour qu’un jour, le traumatisme associé disparaisse. J’ai définitivement renoncé à ne plus éprouver a minima un pincement lorsque je lis le terme qualifiant la manière dont il s’est suicidé ou que je vois une scène du genre au cinéma par exemple. Sur le terme « suicide » c’est en général a peu près accompli. Je peux lire le terme, l’écrire sans que cela soit trop perturbant. Je passe sans aucun doute plus rapidement dessus, je ne m’arrête pas. Le « tw suicide » me rappelle que ce terme a eu un potentiel traumatique pour moi. Il me fait m’arrêter, réfléchir et en général stresser. Bien évidemment j’écris cela simplement pour réfléchir à la manière dont des outils utiles pour certain-e-s peuvent être contreproductifs pour d’autres. Il n’est absolument pas question ici de se moquer ou de dénigrer celles et ceux qui en utilisent.
Mon père était un homme blanc hétérosexuel CSP +. J’en vois certains lever les yeux au ciel à cette énumération ; et pourtant elle est importante pour comprendre le suicide. Ce n’est pas n’importe qui, qui se suicide. Aux USA, même si sans aucun doute on mésestime le taux de suicide des hommes noirs (voir par exemple cet article) , les hommes blancs se suicident davantage.
Mon père était également un homme qui a été résistant, arrêté, torturé et déporté. Il en est sorti avec des handicaps et un syndrome de stress post traumatique profondément important. J’écoute chaque fois avec un mélange d’incrédulité et de colère des gens parler « d’époque victimaire » quand je pense aux millions de déporté-e-s revenu-e-s sans pouvoir parler (se rajoutait en plus pour les déportés juifs, homosexuels ou tziganes, le fait qu’on a longtemps nié, minimisé – et on continue à le faire - la raison pour laquelle ils avaient été déportés) et se trainer des traumatismes profonds sans pouvoir parler. Alors oui je préfère une époque où l’on shoatiserait la main au cul, pour reprendre cette expression immonde de Finkielkraut, reprise par Sabine Prokhoris, aux décennies antérieures, sans aucun doute. Parce que si la shoatisation de la main au cul veut dire qu’on se préoccupe de la santé mentale des gens, que leurs traumas apparaissent à d’autres ridicules ou pas, cela me semble un progrès. Mais bref.
Dans ce texte, je voudrais évoquer ce que la violence des hommes hétérosexuels – et le suicide est un acte de violence – peut faire aux femmes de leur famille. Je ne compte plus au cours de ma vie les gens qui m’ont demandé où nous étions, ma mère et moi, lorsque mon père est mort (« on faisait le nœud » ai-je tendance à répondre). Est-ce que nous n’avions rien vu ? Pourquoi ne nous étions pas occupées de sa santé mentale ?
Depuis deux ans je fréquente les hôpitaux. D’abord pour ma mère, puis pour moi. Les femmes sont partout, elles sont les amies, les sœurs, les femmes, les ex-femmes, les belles-sœurs, les tantes, les filles et bien sûr les patientes. Les hommes sont si peu nombreux ; ils sont des patients, parfois des maris. A tel point que comme toujours, lorsqu’un est présent, il est vu comme un demi-dieu. Sur twitter des assistantes sociales en hôpital m’ont dit avoir vu des cas où des femmes s’occupent des parents de leur ex mari, qui ne veut pas en entendre parler.
Je ne vous apprendrais rien en disant que les femmes sont en charge du care ; elles doivent s’occuper des malades, des enfants, des personnes âgées, des homme célibataires autour d’eux, de leur mari. Et invariablement également lorsqu’un homme commet un acte de violence, une partie de la responsabilité est imputée aux femmes. Même nous féministes lorsqu’un homme nous envoie une dick pic avons parfois la tentation d’en avertir sa mère. Ca vaut pour les violences sexuelles « on l’a cherché », ca vaut pour la délinquance « les mères célibataires ». Derrière un homme violent, se cache toujours une femme qui l’a poussé à le faire.
Alors sans surprise le suicide des homme hétérosexuels est souvent imputé aux femmes. N’ont-elles pas pris assez soin de lui ?
Mon père s’est suicidé âgé. Alors même si évidemment la déportation a un rapport, je ne saurais réduire son acte à cela. Il s’est suicidé alors qu’il était à la retraite (et qui pour a connu les médecins généralistes dans les années 1960 à 1990 dans des petites villes c’étaient des demi-dieux), qu’il avait donc perdu son cercle social, qu’il avait de lourds problèmes de santé. On appelle cela « aggrieved entitlement », l’impossibilité de faire le deuil des privilèges masculins et de réfléchir à la masculinité. Mon père, sans aucun doute, n’a pas supporté, de perdre ses privilèges ; et il y a mis fin comme le font les hommes ; par une intense violence.
Je me suis remémorée il y a peu tout ce que j’avais pu entendre lors de son suicide. Je l’ai additionné aux autres réflexions entendues par des femmes dont les maris, pères, petits-amis s’étaient suicidés. J’ai souvenir d’une fille qui avait quitté son petit ami après une énième crise de violence. Il s’est suicidé en prenant bien soin de dire qu’il le faisait à cause d’elle. Bien évidemment, elle est jugée comme seule responsable de son suicide.
Ma mère et moi avons été jugées comme responsables du suicide de mon père et j’affirme clairement que l’inverse n’aurait pas été. Si ma mère s’était suicidée, on lui aurait reproché d’être une mauvaise épouse et une mauvaise mère, qui abandonne mari et enfant.
Encore une fois donc un acte violent essentiellement pratiqué par des hommes doit ensuite être assumé par les femmes, qui se retrouvent en plus souvent à devoir assumer seules les enfants du couple.
On reproche aux femmes les viols que les hommes ont commis, aux mères les dickpics que leurs fils ont envoyées, aux femmes les coups que les hommes leur ont donnés, aux mères solo les délits que leurs fils ont commis, aux divorcées la violence de leur ex mari et aux épouses les suicides qu’ils commettent. Parce qu’on aurait du se charger de tout cela. Gérer leur santé mentale, gérer leur violence, courber la tête, faire le dos rond.
Je regardais il y a quelques jours « Ils ne vieilliront pas ensemble » de Pialat. A la fin Marlène Jobert arrive enfin à quitter Jean Yanne, un homme misogyne, violent, agressif, cruel. Bien évidemment comme elle lui échappe enfin, il la veut enfin, celle qu’il écrasait de son mépris. Elle lui dit qu’il espère qu’il ne va pas se suicider, car « on le lui reprocherait ».
L’autre point dont je voudrais parler est ce que le suicide provoque. J’ai passé les six mois suivant la mort de mon père à visualiser, couchée dans mon lit, une épée, qui allait s’enfoncer dans ma tête (oui je suis une personne assez simpliste et quand tu parles d’épée de Damoclès je vois une vraie épée). Je ne me suis jamais départie de l’idée que je finirais « comme mon père » et le fait est que je n’aie pas tout à fait tort puisque le suicide est plus fréquent dans les familles où il y en a déjà eu.
Mon père a introduit le suicide dans ma vie. Avant le sien, je n’avais jamais eu aucune pensée suicidaire, j’avais tout un tas de conduites à risque mais pas celle-là. Depuis l’idée de suicide est là et plane. Lorsque je pense au suicide de mon père, la première pensée est la rage de m’avoir transmis un patrimoine aussi pourri. Je n’ai jamais culpabilisé de son suicide (alors que j’ai une tendance assez remarquable à m’en vouloir pour tout et n’importe quoi) mais je l’ai intégré à ma vie. Lorsque ma mère a appris son cancer du pancréas, elle m’a dit qu’elle se suiciderait avant de trop souffrir. Ces temps-ci, puisque j’ai possiblement un pré-cancer (je ne sais même pas ce qu’est un « pré cancer » je retiens davantage le cancer dans l’histoire), j’y pense également. Ce qui est un peu ridicule d’ailleurs ; pour échapper à la mort, allons-y plus vite ! On ne sait pas bien si l’effet Werther et Papageno existent réellement ; il y a de nombreuses controverses sur le sujet. Il ne s’agit évidemment pas de croire, dans la contagion familiale, à croire à une quelconque transmission génétique, ni à un quelconque déterminisme. On me dit très souvent que je ressemble à mon père. C’est vrai, je lui ressemble physiquement, j’ai hérité de ses colères, ses emportements, alors pourquoi n’aurais-je pas hérité de ce bagage là également ?
Avant de commencer ce texte, je voudrais faire une clarification préalable. Je ne suis pas, dans l’état actuel de la société, pour une légalisation du suicide assisté. C’est un constat étrange pour moi puisque le camp politique auquel j’appartiens me semble quasi unanime sur le sujet et que les opposants au suicide assisté sont ramenés à leur « extrémisme religieux » alors que je suis athée.
Je vous invite, au-delà de la réflexion anticapitaliste et antivalidiste qui vont, me semble-t-il, de soi sur ce sujet, à lire ces quelques textes qui lient race et suicide assisté, et celui-ci qui lie genre et suicide assisté. Nous savons qu’il existe des biais sexistes, racistes, classistes dans le soin qui conduira à ce que des personnes racisées, par exemple, soient moins bien soignées que des blanch-e-s. Aux Etats-Unis, s’il y a autant de cancer du sein chez les femmes blanches que noires, ces dernières en meurent bien plus. Nous savons que des biais racistes poussent à moins soulager la souffrance des personnes noires et arabes par exemple parce qu’on pense qu’elles exagèrent leur souffrance et aussi parce qu’on estime qu’elles sont trop peu intelligentes pour comprendre les traitements à prendre.
Il est donc à craindre, dans un contexte, où les pauvres, les femmes, les personnes racisées (et imaginez donc ce qu’il se passerait pour une femme noire pauvre) reçoivent des soins de moins grande qualité et où leur souffrance est moins prise en charge, que ces personnes demandent plus facilement à avoir accès à un suicide assisté. Paranoïa de ma part ? En février 2021, le sénat canadien a demandé à avoir accès à des données concernant les personnes racisées parce qu’il y a crainte que « The amendment reflects concern that Black, racialized and Indigenous people with disabilities, already marginalized and facing systemic discrimination in the health system, could be induced to end their lives prematurely due to poverty and lack of support services. » (crainte que certains demandent à mourir prématurément parce qu’ils sont pauvres et ne bénéficient pas d’aides en tout genre pour supporter leur maladie).
L’absence de questionnements sur le sujet m’interroge et me pousse, dans l’état actuel de notre société, à être plus que dubitative sur le sujet de la légalisation du suicide assisté.
Mais ce texte avait avant tout pour but de répondre à une opposante au suicide assisté, Barbara Lefebvre qui a déclaré la semaine dernière, qu’on pouvait toujours se suicider si on avait une maladie incurable. J’y ai été confronté par le suicide de mon père et ma mère a émis cette idée lorsqu’elle a su avoir une maladie incurable.
En 1998, mon père a 73 ans. Il a un syndrome dépressif jamais traité (du pour partie à sa déportation), il a déjà eu un avc et un infarctus. Il a une tension très élevée que les médicaments ne font pas baisser. Il sait qu’il risque un nouvel avc qui peut le laisser très handicapé, chose qu’il ne supporte pas. Même si je ne saurais résumer son suicide en ces quelques lignes, il est certain que tout cela a joué dans le fait de se suicider le 13 mai 1998.
Il a donc fait exactement ce que vous proposiez Madame Lefebvre.
Mais.
Se suicider implique de choisir une méthode efficace et de n’être pas « dérangé » pour le compléter. Mon père a été découvert avant qu’il soit définitivement mort, si j’ose m’exprimer ainsi. Imaginez-vous Madame, le choc que cela a été pour celle qui l’a découvert ? C’est bien beau de conseiller aux gens le suicide mais soyons un peu pratiques. Comment procède-t-on ? Se suicider implique que votre corps soit découvert ; il faut donc le faire dans un lieu public avec tout ce que cela implique de traumatismes pour les gens qui assisteront à l’acte ou découvriront le corps ou chez soi en espérant que vos proches vous découvrent rapidement. Mon père s'est suicidé et puis il est mort ; tout cela en deux temps. En deux traumatismes.
Voyez-vous Madame Lefebvre je suis une personne extrêmement pratique. Lorsque ma mère m’a dit vouloir se suicider lorsqu’elle souffrirait trop (elle avait un cancer du pancréas), j’ai commencé à réfléchir comment organiser tout cela. I fallait bien que quelqu’un la trouve (et cela ne pouvait être que moi) et ce rapidement (histoire d’éviter une vision de son corps très dégradé). Cela impliquait donc par exemple que ma mère me dise qu’elle se suiciderait le 8 avril, que je passe donc la journée avec cette vision en tête, que, le 9, je débarque gaillardement chez elle pour découvrir son corps et que je prévienne la police et un médecin. Parfait pour faire un deuil, je vous assure.
Mais revenons-en à mon père puisqu’il a pris, selon vous, Madame, la seule décision à adopter face à son état.
Vous aurez déjà compris donc qu’il n’est pas mort tout de suite mais le lendemain avec ce que cela peut susciter d’horreurs pour sa famille, celle qui l’a découvert, ceux qui l’aimaient. Avec a vision de son suicide gravé sur son corps et visible pour nous. Avec l’espoir qu’il va peut-être se réveiller, que le cerveau n’est pas tout à fait mort. Avec l’espoir qu’il va mourir parce que s’il reste dans cet état pendant des années, c’est tout aussi épouvantable. Avec l’idée qui me hante de ne pas savoir la date exacte de sa mort, était-il médicalement mort le 13 ou est-il mort le 14 lorsque son cœur s’est arrêté ? Est-ce que c’est l’acte de décès qui dit la mort ?
Beaucoup de suicides ne sont pas complétés, Madame, quel joie et quel bonheur pour le malade et sa famille de passer à « j’ai une maladie incurable » à « j’ai une maladie incurable et je suis tétraplégique ».
Pouvez-vous imaginer Madame, ce que devient la vie de la famille lorsqu’un de ses membres se suicide ? qu’il ait ou non une « bonne » raison pour le faire ? Comme je l’ai dit, je suis en profond doute face au suicide assisté mais il n’est en rien ressemblant au suicide (voilà pourquoi je préférerais l’appeler euthanasie, d’abord parce que j’ai du mal à écrire le mot « suicide » et ensuite parce qu’il n’y a pas, me semble-t-il dans l’euthanasie, la violence symbolique qu’il y a dans le suicide). Il faut ne jamais avoir vécu de suicide pour comparer les deux, vraiment.
Je ne parlerais que pour moi mais j’ai passé les 20 dernières années à me demander ce que j’aurais pu faire différemment pour que mon père ne passe pas à l’acte, n’accomplisse pas un acte aussi violent, acte que j’ai pris et continue à prendre pour un crachat dans ma figure et celle de ma mère.
Lorsqu’un de vos proches se suicide, Madame, y compris s’il a une maladie incurable, vous serez la coupable de ne pas l’avoir sauvé. Je l’ai vécu, ma mère l’a vécu. On cherchera à savoir où vous étiez, ce que vous lui avez fait ou pas fait.
Lorsqu’un de vos proches se suicide, le suicide devient une de vos options lorsque vous allez mal. J’ai passé les six mois suivant le suicide de mon père à me demander quand je passerais à l’acte à mon tour, persuadée que j’avais désormais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et le fait est qu’à chaque fois que c’est allé mal dans ma vie, cet hypothèse a été présente alors qu’elle ne l’avait jamais été. Les statistiques le démontrent, il y a plus de suicides chez les familles où quelqu’un s’est suicidé que dans les autres.
Ma mère a finalement fait le choix de ne pas se suicider (très égoïstement, cela m’a soulagée, deux parents suicidés, on finit par se dire qu’on a merdé quelque part) et est morte de son cancer, de manière extrêmement douloureuse. Mieux ? Je ne saurais dire. Je peux simplement vous dire que cette mort, n’a en termes de violence, rien à voir avec celle de mon père qui m’a laissé amertume, colère, fureur et haine.
Je reste stupéfaite qu'un débat aussi difficile soit mené par des gens n'y connaissant d'évidence rien, instrumentalisant sans vergogne les malades pour mieux étaler leur ignorance crasse et dangereuse sur le suicide.
"The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world".
Edgar Allan Poe
Hier, une personne m’a dit que ma mère était très belle sur la photo que j’avais jointe au texte parlant de sa mort. Ce n’est pas la première à le faire et je voudrais interroger cette phrase.
Comme de nombreuse femmes, ma mère a passé sa vie au régime, je sais qu’au début de son cancer du pancréas elle était contente d’avoir perdu autant de poids, grâce au cancer. La grand-mère d’un ami qui avait elle aussi lutté toute sa vie pour maigrir était très fière à 90 ans d’être devenue si mince… là encore à cause d’un cancer. C’est un constat terrible parce que toutes deux avaient conscience de la faiblesse extrême que ce poids perdu leur avait causé, ma mère savait qu’elle mourrait de ce cancer mais elle ne pouvait s’empêcher d’en être heureuse.
Ma mère voulait être mince à cause de tous les hommes de sa vie, dont mon père, qui de remarque en humiliation répétées, ne lui ont conféré de la valeur qu’avec un poids inférieur à 55 kilos.
Ma mère a passé sa vie sur des talons hauts qui lui ont tellement abimé les pieds, qu’elle ne rentrait plus dans aucune paire de chaussure à la fin de sa vie et qu’elle avait des douleurs atroces qui l’empêchaient de marcher.
Lorsque j’ai commencé à parler d’euthanasie, je me suis demandée pourquoi les associations pro euthanasie avaient choisi comme « slogan » le « droit de mourir dans la dignité ». Je me demandais ce qu’on appelait dignité, qui est un concept très genré. La dignité des femmes n’est pas celle des hommes, on considère vite qu’une femme est indigne si elle a couché avec des hommes par exemple. On jugera peu digne une femme qui pleure de douleur en la jugeant "hystérique" et "peu viril" un homme qui fait de même. Les attentes en terme de dignité existent pour les hommes et les femmes mais elles sont différentes. Et l’idée de dignité me semble un concept très validiste.
Quelques jours avant de mourir, ma mère a voulu aller aux toilettes refusant une énième fois les toilettes portatives, parce que cela l’obligeait à ensuite aller vider le seau puisqu’elle refusait que je le fasse. Trop faible, elle s’est retrouvée coincée dans la cuvette et c’est mon compagnon qui, au matin, a dû la lever. Je pensais à ma mère pleurant d’humiliation après cet épisode. Je me demandais quel monde nous avons donc construit, pour qu’une femme fatiguée, se sente humiliée de devoir être levée des toilettes alors qu’il s’agit d’un non-évènement si on y réfléchit. Personne n’a à être humilié de devoir être aidé et assisté.
Est-ce que c’est indigne d’être aidée aux toilettes ? Ma mère voulait mourir après cet épisode, ou d’autres similaires. Est-ce qu’elle était belle coincée sur sa cuvette ? Je passe d’autres épisodes, parce que ma mère serait déjà furieuse que je vous raconte tout cela, mais je pensais à tout cela hier en lisant cette personne me dire que ma mère était belle. Et je ne comprends toujours pas, vraiment. Si on estime le physique d’une femme mourante, alors quid des femmes qui ne le sont pas ? Qu’est ce qui est exigé d’elles ? Je repasse dans ma tête le feuilleton des mois de lutte de ma mère contre cette maladie de merde si dévastatrice, si douloureuse et dont une inconnue retient qu’elle était « belle trois semaines avant sa mort. »
Je pense à ses derniers mots « aide moi » (et je n’ai pu le faire) où son visage était déformée par la terreur et la douleur. Et non ma mère n’était pas belle, elle était hideuse et c’est ok.
Je n’ai pas posté la photo de ma mère pour qu’on commente son physique ou la qualité de la photo. J’ai posté cette photo pour l’affronter (parce que c’est une photo difficile à affronter pour moi et que je suis le genre de personne qui se tape sur le pied avec un marteau voir si cela fait mal) et parce qu’il faut montrer que ce que fait la maladie, ce qu’elle enlève. Ma mère quand elle me l’a envoyé m’avait dit « je ne suis pas trop moche ? » et cela me tuait littéralement qu’aussi proche de la mort elle pense encore à cela, comme plein d’autres femmes et comme cela m’arrivera sans nul doute également.
Ce n’est pas neutre que notre premier réflexe, face à n’importe quelle photo de femme, soit de commenter son physique, sa tenue, sa dignité. Nous devrions nous foutre de nous tenir, d’être beaux ou moches, dignes ou indignes.
Dans un monde sexiste comme le nôtre, la dignité des femmes est beaucoup associée à leurs efforts pour tenter de rester jolies ou au moins pas trop moches. On demandera à celles considérées comme laides de faire des efforts pour montrer qu’elles ne sont pas contentes de l’être. On demandera aux jolies de le rester et d’aller se planquer lorsqu’elles ont le mauvais goût de vieillir. Je lis beaucoup, sur les RS, l’idée de « glow up » ; ces femmes ordinaires qui ont eu le bon goût de souffrir et dépenser des fortunes pour devenir plus jolies. J’étais chaque fois frappée quand j’allais voir ma mère à l’hosto du nombre de consultations pour apprendre à nouer son turban, se maquiller, manucure qui étaient proposées… évidemment uniquement aux femmes. Je n’ai évidemment rien contre mais c’est étonnant de se dire qu’une femme, alors qu’elle est en train de lutter contre un cancer, soit dans l’injonction de soigner et préserver sa féminité.
Quand ma mère est morte, j‘ai longtemps regardé son cadavre. J’avais déjà fait de même avec celui de mon père ; je sais qu’un cadavre est un cadavre, dans la quasi-minute, il a l’air de ce qu’il est. C’est moche dans le sens où c’est l’inconnu ; c’est faux à mon avis de prétendre qu’il reste quoi que ce soit de la personne qu’on a connue dans ce truc-là. Je disais dans mon texte précédent regretter qu’on ne pratique pas la toilette mortuaire chez les athées ; j’aurais voulu le faire pour m’approprier cette chair-là devant moi qui est tellement, tellement impressionnant.
Hier je rigolais toute seule en me demandant si le fait d’avoir été belle avant de mourir avait fait d’elle un beau cadavre.
Comme je le disais, la dignité des femmes est profondément associée à leur physique. On louera la femme âgée percluse d’arthrose, qui se fait encore son brushing, on louera la mourante qui a la coquetterie de cacher sa pompe à morphine derrière un foulard. Jusqu’à la fin, on ne nous laisse pas la paix, de crever vieilles et moches, dans notre merde et tout serait ok pour autant.
On ne pardonne pas à Corinne Masiero de se foutre d'être moche ; elle aurait le droit de l'être si elle battait sa coulpe, si elle se cachait, si elle tentait de "s'arranger un peu". Même celles et ceux qui la soutiennent éprouvent le besoin de noter son corps, comme si c'était grave d'être belle ou pas, et qu'il fallait à tout prix la valider.
Merci de m’avoir lue.
J’ai beaucoup hésité à écrire sur ce sujet (la maladie de ma mère, son agonie puis sa mort en juillet) et à le publier. Si j’ai l’habitude de prendre la colère comme moteur d’écriture, je ne suis pas sûre que les sentiments qui m’animent aujourd’hui me réussissent tout autant. Je ne suis pas non plus habituée à parler publiquement d’évènements aussi intimes. Mais je me dis que cracher tout cela publiquement me permettra de, peut-être, enfin réussir à dormir au lieu de ressasser ce qu’il s’est passé.
Je me dis également que lorsque j’ai appris la maladie de ma mère et que j’ai cherché à me préparer à sa mort (ce fut un échec), j’aurais voulu (et non pas aimé) lire ce que je vais écrire là. Dans tout ce merdier, si je peux en tirer quelques analyses, si cela peut être utile à quelqu’un, toute cette souffrance n’aura peut-être pas été totalement vaine.
Enfin les articles autour de Alain Cocq ont été l’ultime déclic. Cocq souffre d’une maladie dégénérative très douloureuse. Après le refus de Macron de lui permettre d’être sédaté jusqu’à sa mort, il a choisi d’arrêter ses soins, de boire et de manger. Tout ceci fut extrêmement médiatisé. A bout de souffrances, Cocq a décidé d’accepter les soins palliatifs et a repoussé ensuite sa décision de mourir. Et là il n’y avait plus aucun media s’intéressant à lui. J’aurais aimé savoir si Cocq avait, avant sa décision de mourir, bénéficié de soins palliatifs de qualité et si sa douleur avait convenablement été prise en charge. C’est une chose de vouloir mourir, c’en est une autre que de le vouloir parce que la médecine ne gère pas vos douleurs alors qu’elle peut le faire.
Lorsque j’ai dit sur twitter que ma mère avait un cancer du pancréas, plusieurs soignant-e-s sont venu-e-s me dire en DM de surveiller que sa douleur était bien gérée. Or, je savais, car beaucoup de médecins me l’avaient également dit, que nous savons contrôler la douleur des malades en fin de vie et ce, jusqu’à un stade très avancé ; nous avons les médicaments pour et nous savons les utiliser. On sait donc contrôler la douleur mais c’est donc visiblement peu et mal fait.
Ce texte se veut donc, aussi, un plaidoyer pour les soins palliatifs, termes qui font peur parce qu’ils impliquent une mort plus que certaine (on peut toujours avoir un doute) , une agonie avec une perte d’autonomie (et dans un monde validiste rien ne fait plus peur) accompagnée de douleurs d’intensités variables.
Je vais parler de validisme dans ce texte. Je vous renvoie au site du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation et son manifeste qui parle ainsi du validisme : « Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Il associe automatiquement la bonne santé et/ou l’absence de handicap à des valeurs positives telles que la liberté, la chance, l’épanouissement, le bonheur, la perfection physique, la beauté. Par opposition, il assimile systématiquement le handicap et/ou la maladie à une triste et misérable condition, marquée entre autre par la limitation et la dépendance, la malchance, la souffrance physique et morale, la difformité et la laideur. »
Même si nous souhaiterions tous et toutes mourir d’un infarctus dans notre sommeil, nous serons beaucoup à mourir comme ma mère, dans la souffrance psychique et physique. Et nous serons peu à nous suicider avant. Autant donc que les soins qu’on nous apportera à ce moment là soient les plus adaptés possibles.
Lorsque j’ai cherché à me documenter sur la fin de vie, j’ai été frappée du nombre de gens dont les proches étaient morts dans des souffrances extrêmes sans qu’ils remettent en cause cette souffrance. Beaucoup demandaient la légalisation de l’euthanasie sans pour autant demander, également, l’universalisation des soins palliatifs et une meilleure prise en charge de la douleur.
Ma mère et moi (nous n’avons pas d’autre famille) avons appris qu’elle avait un cancer du pancréas en septembre 2019. Ce cancer a un des pronostics les plus sombres ; 5 ans après l’annonce du diagnostic, tous stades confondus, seulement 7 à 9% des malades sont encore en vie. Ma mère avait 77 ans et un cancer très avancé.
Dans ces cas-là, la médecine ne prétend pas guérir le malade. On lui propose directement des soins palliatifs. On espère stopper la progression du cancer pendant un moment tout en offrant au malade la meilleure qualité de vie possible. Ma mère a ainsi fait une chimiothérapie palliative ; elle ne prétend pas faire disparaitre la tumeur, mais ralentir sa progression.
Quelqu’un m’a écrit que perdre sa mère était la chose la plus douloureuse (si évidemment on l’aime), je prétends pour ma part avoir fait l’expérience d’une successions de deuils, parfois définitifs, d’autres temporaires. L’absence n’est pas, tout au moins pour moi, la chose la plus difficile à gérer.
Evidemment ici je ne vais parler que de moi. Il ne vous aura pas échappé que ma mère est morte donc il est difficile de la faire parler. Le texte paraitra sans doute d’un grand égoïsme aux personnes malades qui le liront ; il l’est sans aucun doute, je le confesse volontiers.
1. Faire le deuil de son validisme.
Si on reprend la définition du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation en l’appliquant au cancer, il s’agit d’accepter que le malade est seul apte à juger si sa qualité de vie est bonne.
Ma mère m’avait dit au début de sa maladie, qu’elle se suiciderait, ayant vu les ravages du cancer du pancréas chez un de ses amis. Elle ne supporterait pas la douleur mais surtout la perte d’autonomie, me disait-elle. Force est de constater qu’elle s’est adaptée et qu’elle n’a pas vécu cela comme une « perte de dignité », expression validiste qu’on ne cesse de nous seriner face aux malades.
En octobre 2019, à cause du cancer, ma mère a développé un abcès au foie, avec des bactéries très résistantes, qui a dégénéré en septicémie. Son pronostic vital était alors très mauvais. Elle s’est beaucoup affaiblie, ne me reconnaissait plus, perdait le contrôle de certaines fonctions, n’avait plus de pudeur. C’est un moment où j’ai voulu qu’elle meure, « pour elle » me disais-je. Avec le recul, je suis capable de mesurer que c’était surtout pour moi, car je ne supportais pas de la voir dans cet état. C’est là qu’intervient la notion de validisme ; voir la condition physique (et surtout mentale) de quelqu’un changer est difficile mais il convient de ne pas calquer notre propre état de santé sur celui du malade en jugeant que sa vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Ma mère n’a pas conservé de souvenirs de cette période et je dois bien admettre que j’ai du travailler sur moi : accepter que oui, la maladie, ferait peu à peu perdre son autonomie à ma mère. Et alors ? Si elle le vivait bien – et l’entourage – moi – a une part à mon sens importante là-dedans, quelle importance.
15 jours avant sa mort, ma mère ne mangeait plus du tout, elle dormait 20heures par jour d’un mauvais sommeil, elle ne lisait plus ni ne regardait la télé, elle était très défoncée par la morphine et autres. Et pourtant elle m’a plusieurs fois dit « avoir honte mais être heureuse ». Elle était heureuse de mourir chez elle (elle avait peur que je refuse parce que mourir chez elle impliquait que je sois là 24 heures sur 24), la fenêtre ouverte sur son jardin. Heureuse parce qu’elle avait réussi à, à peu près, s’apaiser. Là encore, j’avais plusieurs fois (intérieurement bien sûr) remis en cause l’intérêt de continuer à vivre dans de telles conditions. J’en parle parce qu’il est difficile de voir l’état de quelqu’un se dégrader ; c’est un deuil à faire qui est difficile. Mais si nos sociétés étaient moins validistes, si nous ne voyons pas la dépendance, la perte de contrôle (ex l’incontinence) comme intolérables alors tout cela serait moins mal vécu et par le malade et par sa famille.
Je parle de deuils temporaires car la maladie ne laisse pas de répit. En mai, l’infirmier de ma mère m’appelle car il l’a trouvée dans un très sale état. Je descends donc en plein confinement et je trouve ma mère avec tous les signes d’un AVC (salade de mots, incapacité à répondre à des questions simples, caractère changé etc). Je me souviens rentrer chez elle, dans un Lyon vide – on était en plein confinement – et me dire que ma mère était morte puisque son esprit n’était plus là. J’avais une autre personne en face de moi, totalement différente. Et puis au bout de deux jours, les choses sont à peu près revenues à la normale ; ce n’était pas un AVC mais des séquelles d’une septicémie massive.
Je parle de deuils temporaires car la maladie vous donne l’impression que le malade va mourir dans les jours qui viennent et puis il y a les périodes de rémission où vous vous mettez à lire sur les trois cas mondiaux de miraculés de cancers du pancréas en vous disant que votre mère sera peut-être le quatrième.
Ce qui est difficile à vivre, je crois, c’est de voir combien le malade change mentalement. La dernière semaine de sa vie, ma mère a vu sa dose de morphine doublée par le médecin qui l’a sans doute un peu surdosée, aurait peut-être dû faire des paliers, mais on était en fin de vie et on ne pouvait pas prendre le risque qu’elle ait mal (les douleurs du cancer du pancréas sont extrêmement intenses). Je me suis rendue compte à ce moment-là que je devais dire une nouvelle fois adieu à un morceau de ma mère, la morphine la changeant beaucoup.
Oui il est difficile de voir une personne changer, perdre le contrôle de certaines fonctions, voir son cerveau battre la campagne mais si nous vivions dans une société moins régie par la performance, par l’idée que toute défaillance corporelle est sale, laide et honteuse, nous (malades et proches) le vivrions à mon sens différemment.
2. Faire le deuil de ses certitudes.
On lit souvent des pamphlets contre les médecins et l’acharnement thérapeutique ; mais où commence-t-il ?
J’ai été bannie de twitter parce que j’ai souhaité un cancer (ok c’était très con je l’admets) à un type se prétendant soignant qui me disait qu’il était de l’ordre de l’acharnement thérapeutique que de faire faire une chimio à ma mère. Je ne saurais dire si la chimio a permis à ma mère de mourir moins vite. Je sais en revanche dire qu’elle a souhaité cette chimio même si elle a été difficile. Je sais en revanche qu’elle a dit aux médecins qu’il fallait « tout tenter » pour lui donner un peu de temps et je sais aussi que les médecins ont parfois du mal à lâcher un patient parce que c’est difficile de se dire qu’on ne gagnera pas cette fois-ci.
Peut-être à la fin de sa vie, qu’il aurait fallu arrêter certains traitements plus précocement. Parce que tout traitement a des effets secondaires qu’il faut pallier par d’autres traitements, qui eux-mêmes en ont également. Peut-être a-t-on poussé trop loin. Peut-être aurait-on du sédater 24 heures plus tôt.
Mais je n’ai là-dessus aucune certitude parce qu’il est difficile de savoir ce qui est bon pour le malade et non pas pour soi.
3 jours avant de mourir, ma mère a développé une encéphalopathie hépatique. C’était prévu et les produits de sédation étaient prêts (pour expliquer. La loi Leonetti permet, si le patient est sur le point de mourir et que ses douleurs ne peuvent être soulagées, de le sédater profondément). Ma mère avait rédigé ses dernières volontés en demandant à être sédatée dans trois conditions :
- si la morphine n’était plus efficace face aux douleurs physiques
- si les anxiolytiques n’étaient plus efficaces face aux angoisses
- si elle était en insuffisance respiratoire
Un matin ma mère s’est réveillée dans un état de terreur absolue. J’ai déjà fait des crises de panique, j’ai déjà vu des gens faire des crises de panique ou d’angoisse majeures ; imaginez cela, multipliez-les par 1000 et vous aurez une vague idée de l’état de ma mère. Elle hurlait, pleurait. Malheureusement ses tout derniers mots auront été « aide moi » et le fait est que je ne pouvais pas l’aider, sinon à appeler l’infirmière pour qu’elle arrive au plus vite.
J’ai fait pression pour qu’elle soit sédatée en indiquant bien que les angoisses étaient majeures (j’ai appris ensuite en faisant mes recherches que l’encéphalopathie hépatique pouvait causer des terreurs, des hallucinations). Ma mère étant hospitalisée a domicile et son oncologue étant à 100 km, les décisions se prenaient par téléphone. J’ai donc dû insister une nouvelle fois pour que les doses d’hypnovel soient augmentées car lorsque nous bougions ma mère elle se mettait à hurler, à pleurer, à crier « non » tellement elle avait apparemment peur de tomber.
Je dois faire le deuil de cette décision. J’aurais aimé retarder la sédation espérant que le cerveau de ma mère revienne 5 minutes et que, comme dans les films, on se dise adieu et où elle me donne des conseils à la con sur comment mener ma vie. Même une de ses phrases de droite, j’étais preneuse.
J’aurais aimé accélérer la sédation car je m’en veux de cette matinée ou elle s’est réveillée terrorisée et je me dis que si j’avais emmerdé mon monde la veille, elle aurait été sédatée plus tôt. Il n’y a pas de bonne décision dans de tels cas et c’est difficile à admettre surtout pour quelqu’un comme moi qui aime ce qui est manichéen et binaire.
Et je comprends les médecins qui ont du mal à se dire que c’est terminé, qu’ils veulent tenter encore un truc, qui veulent soulager en entrainant des réactions en chaine difficiles à prévoir.
3. Faire le deuil de la rationalité
J’ai lu plusieurs fois de sérieuses engueulades sur le fait de dire ou pas la vérité aux malades.
Ma mère a appris en avril qu’elle avait des métastases osseuses ; ce n’est pas une réalité qu’elle a pu intégrer et elle me parlait de « son arthrose ». Fin mai, elle a pu prononcer les mots et ses métastases osseuses sont devenues pour elle une réalité avec laquelle elle pouvait vivre.
Il est difficile dans ces cas-là de réinsister ; « non tu ne dois pas faire d’effort sollicitant ton dos à cause des métastases ». « tu as très mal à cause des métastases donc oui il est logique qu’on augmente ta morphine ». Une fois que la vérité est dite, il est difficile de réinsister si le malade ne peut pas/ne veut pas l’entendre. Chacun-e son rythme.
Une heure après avoir appris que c’était désormais une question de jours, ma mère m’a demandé ce que je voulais à Noël avec une tournure de phrase laissant entendre qu’elle serait là. Ce n’était pas du déni, simplement son cerveau lui a laissé un moment de répit bienvenu.
J’ai évidemment dit ce que je voulais à Noël parce que mentir était nécessaire et utile.
Bien malin est celui ou celle qui sait qu'il ne faut pas mentir.
4. Faire le deuil des traumatismes
C’est la partie que j’ai le plus hésité à écrire car c’est peut-être la chose la plus impudique que j’aurais jamais écrite. J’ai l’impression de transgresser un grand tabou en le faisant.
J’ai souhaité lorsque j’ai appris que ma mère allait mourir, m’y préparer (quelle prétention). J’ai ainsi appris l’existence des râles agoniques, qui me terrorisaient. Ils définissent la phase (si j’ai bien compris) où le malade est désormais trop faible pour tousser. Les secrétions s’accumulent au fond de sa gorge, l’air passe au milieu et cela produit un râle. Il n’est pas douloureux pour le malade mais très difficile à entendre pour l’entourage. Certaines études prétendent d’ailleurs que le médicament administré pour tenter de faire passer les sécrétions est surtout intéressant pour la santé psychique de l’entourage, bien plus que pour le malade.
Trois jours avant de mourir, ma mère a commencé à avoir un comportement étrange, que j’ai mis sur le dos de la morphine ; la dose ayant été plus que doublée, il était logique qu’elle soit très HS. Elle a eu quelques hallucinations mais la morphine peut en provoquer. Un soir elle a commencé à refuser l’oxygène, avec une voix de petite fille, elle voulait absolument déambuler dans la maison alors qu’elle en était incapable, je devais donc littéralement la porter d’un endroit à l’autre. L’infirmière est venue en urgence et lui a administré un valium.
elle s’est réveillée à 5 heures du matin en pleine panique avec ces fameux râles agoniques. C’est là que le processus de sédation a été mis en place. Ce qui est assez fou, c’est que je n’ai pas été capable de comprendre ce que c’était alors que j’avais beaucoup lu sur le sujet. Le cerveau humain est curieusement fait.
Ces râles sont indescriptibles, un mélange de toux glaireuse, de ronflement ; ils sont très traumatisants je le confirme (désolée c’est le max que je peux dire là-dessus, je ne sais pas parler de ce que je ressens).
L’hypnovel (le médicament qui sédate) a ensuite été augmenté car visiblement ma mère continuait à être très angoissée. C’est vraiment la chose que je regrette ; qu’aucun soignant ne m’ait dit qu’il y avait un risque de terreurs et d’hallucinations avec une encéphalopathie.
Il y a eu un moment difficile où j’ai du aider l’infirmière à enlever les bagues de ma mère (ses doigts avaient énormément gonflé et cela faisait compression). J’ai eu l’impression de la détrousser ; et de l’autre cela m’a rassurée sur l’efficacité de l’hypnovel car on a vraiment tiré comme des malades sans qu’elle bouge un sourcil.
Le 15 juillet au soir, j’ai eu le sentiment que ma mère allait mourir. Certes comme tous les soirs depuis 8 mois mais ce jour là c’était un peu plus fort. Je l’ai trouvée agitée, le visage crispée, les mains qui bougent spasmodiquement. J’avais l’autorisation de faire des bolus (avec une pompe à médicament, le malade reçoit des médicaments en continu et il peut s’en injecter une dose d’un seul coup ; on appelle cela un bolus) de morphine et hypnovel et c’est ce que j’ai fait. Elle s'est apaisée ; le visage s'est décrispé, les mains sont retombées sur le drap. Malgré cela j'ai su qu'elle allait mourir dans la nuit. Je suis allée dormir, ce que je n'ai pas réussi à faire.
Le lendemain elle était morte. J’ai débranché la pompe à oxygène. Il y a quelque chose que je trouve très bien dans la religion musulmane (peut-être que cela existe dans les autres monothéismes je ne sais pas) c’est la place accordée à la toilette mortuaire ; je pense que cela permet de pleinement réaliser les choses. Sans vouloir faire sa toilette, j’aurais voulu enlever les tuyaux qu’elle avait de partout, cela m’aurait donné l’impression de mettre un point final. Malheureusement les infirmières n’ont pas voulu.
Et voilà l’histoire s’arrête ici.
Si je devais tirer quelques conclusions de cette expérience :
- lire beaucoup et davantage les militant-e-s qui nous informent sur le validisme
- un rapport est paru sur les soins palliatifs ; faire le même rapport côté malades
- comprendre pourquoi la douleur est si mal prise en charge alors qu’on sait le faire ; on sait déjà par les militant-e-s qu’il y a des raisons sexistes/racistes à certaines non prises en charge.
Dans le cas de ma mère il y a sans nul doute un manque d’écoute (du à plein de choses). Lorsque ma mère leur disait que « ca allait » et que je creusais, je découvrais qu’elle était à 5 de douleur. Parce qu’elle ne voulait pas « emmerder les gens », parce qu’elle avait « l’impression de devenir douillette » , parce qu’elle « avait peur que si elle prenait trop de calmants maintenant ils n’agissent plus ensuite ».
- ne pas minorer les angoisses. J’ai demandé et insisté à ce que ma mère soit sédatée à cause de ses terreurs ; les soignant-e-s avaient ses dernières volontés sous le nez mais ils avaient zappé le passage sur les angoisses.

Il y a quelques temps j'ai écrit cet article sur la difficulté à voir vieillir les femmes. Je me suis dit que c'était un petit geste militant de poster cette photo de ma mère, trois semaines avant sa mort. Le cancer lui a pris sa graisse et ses muscles. Ses pupilles sont dilatées à cause de la morphine, symbolisée par le petit sac bleu qui lui en délivre. La maladie l'empêche de boire du vin, elle a donc une menthe à l'eau. Elle essaie de cacher la pompe à morphine avec un foulard qui a bougé, et l'autre foulard essaie de dissimuler ses cheveux trop longs. A côté d'elle, son déambulateur. C'est à la fois elle et plus tout à fait elle. La maladie vole beaucoup de choses.
merci de m’avoir lue
Bonjour à toutes et toutes
J'ai la grande joie de vous annoncer la sortie de mon livre "Une culture du viol à la française. Du troussage de domestique à la liberté d'importuner." le 21 février 2019 aux Editions Libertalia.
Le livre est en précommande via ce lien.
Des dates de présentation du livre sont prévues ; je mettrai l'article à jour au fur et à mesure 🙂
J'ai très hâte d'avoir vos retours (et du stress aussi oui ! ) et d'éventuellement vous rencontrer.

Voici les premières dates de présentation du livre :
Paris, mardi 19 février, 19 heures, Violette and Co 102, rue de Charonne, 75011 Paris.
Marseille, vendredi 22 février, 19 heures, librairie L’Hydre aux mille têtes, 96, rue Saint-Savournin, 13001 Marseille.
Lyon, samedi 23 février, 15 heures, librairie Terres des livres, 86, rue de Marseille, 69007 Lyon.
Hier j’ai posté un thread sur twitter sur les féminicides ; j’y expliquais que les hommes qui tuent leur compagne sont en général vierges d’autres crimes comparables. Les hommes violents avec leur compagne ne sont pas pour l’immense majorité, violents avec d’autres hommes. Sans surprise, des hommes sont venus me balancer des statistiques sur les homicides – comme si je pouvais les ignorer – pour m’expliquer que les hommes tuent avant tout d’autres hommes, chose que je n’avais évidemment jamais contestée et qui n’était pas le propos de mon thread.
Je suis comme toujours allée jeter un œil sur leur TL ; aucune évocation, à aucun moment d’un quelconque engagement face à ce sujet. Les chiffres sur les hommes qui sont tués ont juste été utilisés pour tenter de desservir mon propos (ce qui n’est pas grave), et de minorer le nombre de femmes tuées par leur conjoint (ce qui l’est bien davantage).
j’ai de plus en plus tendance – parce que je suis concernée par les deux sujets d’ailleurs – à comparer ce genre de rhétorique à la rhétorique négationniste. Ces hommes n’en ont rien à foutre des hommes assassinés, des hommes qui se suicident sauf si cela peut leur permettre de tenter de faire taire une féministe qui parle de la souffrance des femmes. C’est quand même assez fascinant de haïr à ce point les femmes que de nier qu’elles sont, parfois, tuées par un homme.
Mon père s’est suicidé. Cela a fait 20 ans cette année ; cela a été un anniversaire compliqué. Même si cela n’explique évidemment pas tout et qu’il y a des raisons singulière et individuelles à son acte, j’ai depuis longtemps une très claire vision de ce que cela peut être d’être un homme et des contraintes viriles. J’évoquais le négationnisme parce que mon père était également un ancien déporté et, sans surprise, 50 ans de syndrome de stress post traumatique non traité car « un homme ca ne va pas chez le psy » ont pu participer à son suicide.
Je suis donc, tant humainement qu’intellectuellement, scandalisée et peinée pour tout dire par les méthodes de ces hommes. Pensent-ils sérieusement que les militantes féministes ignorent les statistiques ? pensent-ils qu’elles ne connaissent pas le coût de la virilité ?
J’avais lu un très bon texte où une militante féministe anglaise expliquait la différence de réception de ses travaux lorsqu’elle travaille sur les hommes et les femmes. Si je me souviens bien de son travail, elle travaille sur les violences sexuelles subies par les femmes et elle aide également les hommes SDF. A chaque fois qu’elle a évoqué son travail sur les femmes, elle a reçu des tombereaux d’injures voire de menaces. Elle na jamais été insultée ou menacée lorsqu’elle évoque son travail sur les hommes ; il est loué et complimenté et jamais critiqué. Personne ne lui a jamais rappelé que certes il y a plus d’hommes SDF mais beaucoup plus de femmes pauvres par exemple. Au contraire lorsqu’elle publie sur les violences sexuelles faites aux femmes, on lui explique que des hommes sont violés (elle le sait), que tous les hommes ne sont pas des violeurs (elle ne l’a jamais dit). Tout est là pour minorer les statistiques concernant les violences sexuelles.
Cela me rappelle très exactement le négationnisme en clair. Les négationnistes passent leur temps à instrumentaliser d’autres génocides, d’autres assassinats de masse (dont ils se foutent éperdument, ils ne les évoquent jamais hors contexte du génocide juif) pour mieux nier le génocide juif. Ils le font – c’est une évidence mais dans ces temps de confusion politique peut-être en suis-je réduite à devoir le rappeler – parce qu’ils haïssent les juifs, parce qu’ils sont antisémites. Il n’y a jamais eu d’autres raisons au négationnisme que celle-là et il n’y a aucune autre raison que la haine des femmes au masculinisme. Le masculinisme n’a jamais défendu les hommes sinon il se préoccuperait de leur suicide ou du nombre d’hommes assassinés. Le masculinisme est juste là pour nier les souffrances des femmes parce que ses militants nous haïssent cela n’est pas plus compliqué que cela. Ce type de masculinistes n’a pas fait des souffrances masculines son combat ; après tout il y a désormais plein d’études sur la masculinité, pourquoi n’en prendraient ils pas leur part ? mais non les morts sont à juste pour minorer les femmes assassinées. C’est une haine qui m’est assez incompréhensible, je dois l’avouer.
Lorsque je vous avais parlé de ma wishlist, je ne m'attendais pas à ceci. (oui je suis exceptionnellement douée en photo comme vous le constatez).
Alors tellement, tellement, tellement merci.
Je ferai sans aucun doute un article pour chaque livre mais je ne saurais que vous conseiller, pour Noël, de penser à offrir le magnifique La belle et la bête, ou Café society.
La nuit du chasseur contient un magnifique livre de photos et Illicit est quant à lui un film du Pre-code ; la warner sort énormément de films de cette période.
Je ferai évidemment un résumé de chacun des ouvrages féministes.
Mais.. merci 🙂 (je me répète non).
Lors de notre première réunion sur la masculinité, nous nous sommes chacun présentés en disant pourquoi nous étions là. J'avais a priori un simple rôle de modératrice mais, lorsque mon tour est venu, l'évidence m'est apparue ; j'étais là à propos du suicide de mon père.
J'évoque assez peu mes expériences personnelles quand je parle de féminisme. Déjà parce que je sais - et je l'ai souvent expérimenté - que c'est matière à trolling. Ensuite je me défie assez de mes émotions. Mais je vais en parler ici car je pense que cela a son importance et permettra de peut-être saisir ce que peut engendrer la constriction virile.
Terminons ce voyage en Floride, dont vous pouvez lire les différentes étapes ici, en parlant des Everglades et des Keys.
Le parc des Everglades couvre une zone de 15 000 mm² est est la seule région en Floride à être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Il s'agit d'une zone humide subtropicale de savanes et prairies inondables. Vous pouvez y faire du speedboat (on en voit un dans le générique des Experts Miami) mais c'et à déconseiller car totalement irrespectueux de la faune et de la flore.