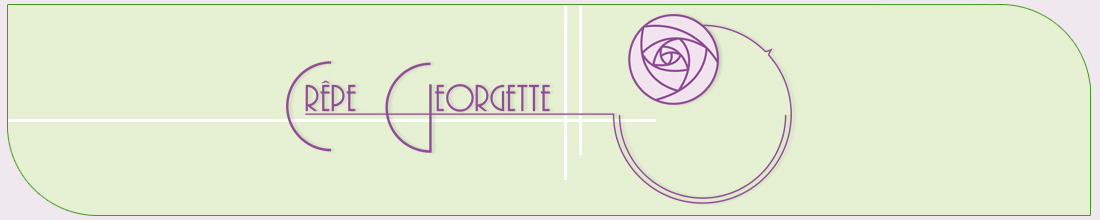C’est assez étrange que je choisisse de vous parler d’un des sujets qui est le plus traumatique pour moi, le suicide, à un moment où je suis extrêmement fragile. A ce sujet je fais un bref aparté sur les trigger warning. Je suis toujours étonnée (et le terme n’implique aucun espèce de jugement) que certain-e-s les jugent utiles pour eux-mêmes. Le tw suicide, a, a contrario, un effet extrêmement négatif pour moi. Je m’explique.
Mon père s’est suicidé en 1998. Depuis cette date, je lutte donc pour qu’un jour, le traumatisme associé disparaisse. J’ai définitivement renoncé à ne plus éprouver a minima un pincement lorsque je lis le terme qualifiant la manière dont il s’est suicidé ou que je vois une scène du genre au cinéma par exemple. Sur le terme « suicide » c’est en général a peu près accompli. Je peux lire le terme, l’écrire sans que cela soit trop perturbant. Je passe sans aucun doute plus rapidement dessus, je ne m’arrête pas. Le « tw suicide » me rappelle que ce terme a eu un potentiel traumatique pour moi. Il me fait m’arrêter, réfléchir et en général stresser. Bien évidemment j’écris cela simplement pour réfléchir à la manière dont des outils utiles pour certain-e-s peuvent être contreproductifs pour d’autres. Il n’est absolument pas question ici de se moquer ou de dénigrer celles et ceux qui en utilisent.
Mon père était un homme blanc hétérosexuel CSP +. J’en vois certains lever les yeux au ciel à cette énumération ; et pourtant elle est importante pour comprendre le suicide. Ce n’est pas n’importe qui, qui se suicide. Aux USA, même si sans aucun doute on mésestime le taux de suicide des hommes noirs (voir par exemple cet article) , les hommes blancs se suicident davantage.
Mon père était également un homme qui a été résistant, arrêté, torturé et déporté. Il en est sorti avec des handicaps et un syndrome de stress post traumatique profondément important. J’écoute chaque fois avec un mélange d’incrédulité et de colère des gens parler « d’époque victimaire » quand je pense aux millions de déporté-e-s revenu-e-s sans pouvoir parler (se rajoutait en plus pour les déportés juifs, homosexuels ou tziganes, le fait qu’on a longtemps nié, minimisé – et on continue à le faire - la raison pour laquelle ils avaient été déportés) et se trainer des traumatismes profonds sans pouvoir parler. Alors oui je préfère une époque où l’on shoatiserait la main au cul, pour reprendre cette expression immonde de Finkielkraut, reprise par Sabine Prokhoris, aux décennies antérieures, sans aucun doute. Parce que si la shoatisation de la main au cul veut dire qu’on se préoccupe de la santé mentale des gens, que leurs traumas apparaissent à d’autres ridicules ou pas, cela me semble un progrès. Mais bref.
Dans ce texte, je voudrais évoquer ce que la violence des hommes hétérosexuels – et le suicide est un acte de violence – peut faire aux femmes de leur famille. Je ne compte plus au cours de ma vie les gens qui m’ont demandé où nous étions, ma mère et moi, lorsque mon père est mort (« on faisait le nœud » ai-je tendance à répondre). Est-ce que nous n’avions rien vu ? Pourquoi ne nous étions pas occupées de sa santé mentale ?
Depuis deux ans je fréquente les hôpitaux. D’abord pour ma mère, puis pour moi. Les femmes sont partout, elles sont les amies, les sœurs, les femmes, les ex-femmes, les belles-sœurs, les tantes, les filles et bien sûr les patientes. Les hommes sont si peu nombreux ; ils sont des patients, parfois des maris. A tel point que comme toujours, lorsqu’un est présent, il est vu comme un demi-dieu. Sur twitter des assistantes sociales en hôpital m’ont dit avoir vu des cas où des femmes s’occupent des parents de leur ex mari, qui ne veut pas en entendre parler.
Je ne vous apprendrais rien en disant que les femmes sont en charge du care ; elles doivent s’occuper des malades, des enfants, des personnes âgées, des homme célibataires autour d’eux, de leur mari. Et invariablement également lorsqu’un homme commet un acte de violence, une partie de la responsabilité est imputée aux femmes. Même nous féministes lorsqu’un homme nous envoie une dick pic avons parfois la tentation d’en avertir sa mère. Ca vaut pour les violences sexuelles « on l’a cherché », ca vaut pour la délinquance « les mères célibataires ». Derrière un homme violent, se cache toujours une femme qui l’a poussé à le faire.
Alors sans surprise le suicide des homme hétérosexuels est souvent imputé aux femmes. N’ont-elles pas pris assez soin de lui ?
Mon père s’est suicidé âgé. Alors même si évidemment la déportation a un rapport, je ne saurais réduire son acte à cela. Il s’est suicidé alors qu’il était à la retraite (et qui pour a connu les médecins généralistes dans les années 1960 à 1990 dans des petites villes c’étaient des demi-dieux), qu’il avait donc perdu son cercle social, qu’il avait de lourds problèmes de santé. On appelle cela « aggrieved entitlement », l’impossibilité de faire le deuil des privilèges masculins et de réfléchir à la masculinité. Mon père, sans aucun doute, n’a pas supporté, de perdre ses privilèges ; et il y a mis fin comme le font les hommes ; par une intense violence.
Je me suis remémorée il y a peu tout ce que j’avais pu entendre lors de son suicide. Je l’ai additionné aux autres réflexions entendues par des femmes dont les maris, pères, petits-amis s’étaient suicidés. J’ai souvenir d’une fille qui avait quitté son petit ami après une énième crise de violence. Il s’est suicidé en prenant bien soin de dire qu’il le faisait à cause d’elle. Bien évidemment, elle est jugée comme seule responsable de son suicide.
Ma mère et moi avons été jugées comme responsables du suicide de mon père et j’affirme clairement que l’inverse n’aurait pas été. Si ma mère s’était suicidée, on lui aurait reproché d’être une mauvaise épouse et une mauvaise mère, qui abandonne mari et enfant.
Encore une fois donc un acte violent essentiellement pratiqué par des hommes doit ensuite être assumé par les femmes, qui se retrouvent en plus souvent à devoir assumer seules les enfants du couple.
On reproche aux femmes les viols que les hommes ont commis, aux mères les dickpics que leurs fils ont envoyées, aux femmes les coups que les hommes leur ont donnés, aux mères solo les délits que leurs fils ont commis, aux divorcées la violence de leur ex mari et aux épouses les suicides qu’ils commettent. Parce qu’on aurait du se charger de tout cela. Gérer leur santé mentale, gérer leur violence, courber la tête, faire le dos rond.
Je regardais il y a quelques jours « Ils ne vieilliront pas ensemble » de Pialat. A la fin Marlène Jobert arrive enfin à quitter Jean Yanne, un homme misogyne, violent, agressif, cruel. Bien évidemment comme elle lui échappe enfin, il la veut enfin, celle qu’il écrasait de son mépris. Elle lui dit qu’il espère qu’il ne va pas se suicider, car « on le lui reprocherait ».
L’autre point dont je voudrais parler est ce que le suicide provoque. J’ai passé les six mois suivant la mort de mon père à visualiser, couchée dans mon lit, une épée, qui allait s’enfoncer dans ma tête (oui je suis une personne assez simpliste et quand tu parles d’épée de Damoclès je vois une vraie épée). Je ne me suis jamais départie de l’idée que je finirais « comme mon père » et le fait est que je n’aie pas tout à fait tort puisque le suicide est plus fréquent dans les familles où il y en a déjà eu.
Mon père a introduit le suicide dans ma vie. Avant le sien, je n’avais jamais eu aucune pensée suicidaire, j’avais tout un tas de conduites à risque mais pas celle-là. Depuis l’idée de suicide est là et plane. Lorsque je pense au suicide de mon père, la première pensée est la rage de m’avoir transmis un patrimoine aussi pourri. Je n’ai jamais culpabilisé de son suicide (alors que j’ai une tendance assez remarquable à m’en vouloir pour tout et n’importe quoi) mais je l’ai intégré à ma vie. Lorsque ma mère a appris son cancer du pancréas, elle m’a dit qu’elle se suiciderait avant de trop souffrir. Ces temps-ci, puisque j’ai possiblement un pré-cancer (je ne sais même pas ce qu’est un « pré cancer » je retiens davantage le cancer dans l’histoire), j’y pense également. Ce qui est un peu ridicule d’ailleurs ; pour échapper à la mort, allons-y plus vite ! On ne sait pas bien si l’effet Werther et Papageno existent réellement ; il y a de nombreuses controverses sur le sujet. Il ne s’agit évidemment pas de croire, dans la contagion familiale, à croire à une quelconque transmission génétique, ni à un quelconque déterminisme. On me dit très souvent que je ressemble à mon père. C’est vrai, je lui ressemble physiquement, j’ai hérité de ses colères, ses emportements, alors pourquoi n’aurais-je pas hérité de ce bagage là également ?
Dans ma tête, tourne en boucle l’idée qu’un homme accusé de viols est ministre de l’Intérieur.
Dans ma tête, tourne en boucle Goldnadel relativisant en plateau télé le viol d’un ado de 13 ans en disant que ce n’est pas la sodomie d’un enfant de 3.
J’entends les journalistes, certaines féministes, parler de « libération de la parole » et j’ai l’impression de devenir cette mamie ronchon, que les petits-enfants ne veulent plus visiter, parce qu’elle trouvera les bonbons (150 euros le kilo au meilleur pâtissier du coin) un peu aigres. Je n’arrive pas à me réjouir parce que j’ai l’impression que cette libération de la parole n’est pas accompagnée, pas aidée, pas soutenue, qu’elle génère beaucoup d’attente et qu’on se retrouve seul-es après avoir parlé, toujours seul-es avec en plus la certitude qu’on s’en fout.
Dans ma tête, celles et ceux qui nous accusent de puritanisme devraient a minima admettre, s’ils ne veulent pas parler de viol, que Darmanin a reconnu avoir échangé avec des femmes précaires, en grande fragilité psychologique et matérielle, de l’aide contre du sexe. Et dans ma tête, il n’y a aucun monde où c’est ok de faire cela y compris chez les grands bourgeois qui se parent de toutes les vertus tout en troussant les domestiques.
Dans ma tête, on a tous et toutes balancé nos tripes et nos traumas sur la table en espérant grapiller trois miettes d’aide psychologique, un fond de budget sorti tout droit de mon cul. Le privé est politique, certes, mais crevait-on d’envie d’écrire sur un réseau social public qu’on s’est faite fourrer la bouche, le vagin et l’anus en espérant susciter un peu de réaction politique en face.
Oh on ne l’a pas dit comme cela, on a mis des périphrases et des mots proprets. On n’a pas détaillé, parce que le viol salit les victimes, le récit du viol salit les victimes.
Ma mère a mis 28 ans à admettre que j’avais bien été violée et que je n’avais pas menti. Cela a été bref « ah ok je pensais que tu avais menti. Eh ben désolée ». Cela ne m’a pas fait le bien que j’espérais, c’était un peu tard, un peu léger mais quand même ça sert. Sans comparer ma mère au collectif, c’est nécessaire d’avoir une réponse collective forte face aux témoignages de victimes. Pas de l’ordre « et alors on va tous les foutre en taule et perdre la clé » mais « et on va se demander pourquoi cela arrive autant et comment faire pour que cela arrive de moins en moins ».
La libération de la parole a réussi à être instrumentalisée ; maintenant que vous avez parlé, peut-être pourrait-on passer à autre chose non ? Qu’est-ce que vous voulez EN PLUS ?
Dane ma tête, tourne en boucle l’idée que Macron a fait pression pour que soit nommé Darmanin, parce qu’il lui faut taper dans la droite la plus traditionnelle pour espérer gagner 2022, ca serait compliqué de compter une nouvelle fois sur la peur du FN. Eh ma foi qu’il ait violé ou non, abusé ou non, exagéré ou non, n’a sans doute pas compte une seule seconde. J’aimerais espérer qu’ils se soient posés la question, moi qui ai tant cru que nous féministes étions suffisamment fortes désormais pour que notre opinion compte. J’imagine les réunions qu’il y a eues, la communication à prévoir pour anticiper… rien. Il n’y a rien eu. A part quelques féministes qui gueulent inlassablement sur les réseaux sociaux, qu’un violeur est à la tête d’un ministère et que si tu ne veux pas appeler cela viol appelle le « belle saloperie qu’il a reconnue et qui est un peu plus grave que bouffer du homard au frais du contribuable ». Les français dans leur ensemble se contrefoutent du symbole Darmanin ; belle manière de chier sur l’ensemble des victimes de viol.
J’ai une infinie dépression qui se traine et se dandine, à savoir qu’on ne parlera jamais du viol que pour faire expulser des doubles-natio, promettre 250 ans de prison aux pédos bref à mener une politique raciste et carcérale qui n’a jamais rien résolu mais qui arrange le péquin qui s’est créé un frisson à la colonne vertébrale en lisant les sodomies de Matzneff.
Je me souviens il y a presque 20 ans le procès Dutroux. J’étais mal, si mal à cette époque là que j’avais tout lu, tout regardé y compris les rapports d’autopsie des gamines. Je baignais en plein complotisme parce qu’il était plus simple d’imaginer des notables protégeant Dutroux qu’une simple incompétence, une simple flemme, une simple guéguerre flics/gendarmes qui mènent à la mort d’enfants. Si c’était juste cela, alors il n’y avait plus qu’à tout arrêter parce que je ne voulais pas vivre dans ce monde là. On était sur le forum des chiennes de garde à cette époque, à déjà parler de nos viols et déjà on nous expliquait que face à l’affaire Dutroux, ce qui nous était arrivé n’était pas si grave.
20 ans après c’est le même cinéma rien ne change. On ne nie plus la parole des victimes, Goldnadel explique à la télé, sans être immédiatement foutu dehors à coups de pied au cul, que ce n’est pas comparable à la sodomie d’un enfant de 3 ans.
La grande évolution est là finalement, peut-être encore plus cruelle que ce que j’avais envisagé ; nous croire mais nous dire qu’on s’en fout. Nous croire mais nous dire qu’il n’y a pas mort d’homme ou sodomie de môme. Nous croire et que rien ne change.
A la fin il ne restera que les monstres, les Dutroux et Fourniret. Ceux qui ont torturé, violé, brisé en morceaux et qui seront toujours ceux qu’on convoquera pour mieux excuser les autres, tous les autres.
Avant de commencer ce texte, je voudrais faire une clarification préalable. Je ne suis pas, dans l’état actuel de la société, pour une légalisation du suicide assisté. C’est un constat étrange pour moi puisque le camp politique auquel j’appartiens me semble quasi unanime sur le sujet et que les opposants au suicide assisté sont ramenés à leur « extrémisme religieux » alors que je suis athée.
Je vous invite, au-delà de la réflexion anticapitaliste et antivalidiste qui vont, me semble-t-il, de soi sur ce sujet, à lire ces quelques textes qui lient race et suicide assisté, et celui-ci qui lie genre et suicide assisté. Nous savons qu’il existe des biais sexistes, racistes, classistes dans le soin qui conduira à ce que des personnes racisées, par exemple, soient moins bien soignées que des blanch-e-s. Aux Etats-Unis, s’il y a autant de cancer du sein chez les femmes blanches que noires, ces dernières en meurent bien plus. Nous savons que des biais racistes poussent à moins soulager la souffrance des personnes noires et arabes par exemple parce qu’on pense qu’elles exagèrent leur souffrance et aussi parce qu’on estime qu’elles sont trop peu intelligentes pour comprendre les traitements à prendre.
Il est donc à craindre, dans un contexte, où les pauvres, les femmes, les personnes racisées (et imaginez donc ce qu’il se passerait pour une femme noire pauvre) reçoivent des soins de moins grande qualité et où leur souffrance est moins prise en charge, que ces personnes demandent plus facilement à avoir accès à un suicide assisté. Paranoïa de ma part ? En février 2021, le sénat canadien a demandé à avoir accès à des données concernant les personnes racisées parce qu’il y a crainte que « The amendment reflects concern that Black, racialized and Indigenous people with disabilities, already marginalized and facing systemic discrimination in the health system, could be induced to end their lives prematurely due to poverty and lack of support services. » (crainte que certains demandent à mourir prématurément parce qu’ils sont pauvres et ne bénéficient pas d’aides en tout genre pour supporter leur maladie).
L’absence de questionnements sur le sujet m’interroge et me pousse, dans l’état actuel de notre société, à être plus que dubitative sur le sujet de la légalisation du suicide assisté.
Mais ce texte avait avant tout pour but de répondre à une opposante au suicide assisté, Barbara Lefebvre qui a déclaré la semaine dernière, qu’on pouvait toujours se suicider si on avait une maladie incurable. J’y ai été confronté par le suicide de mon père et ma mère a émis cette idée lorsqu’elle a su avoir une maladie incurable.
En 1998, mon père a 73 ans. Il a un syndrome dépressif jamais traité (du pour partie à sa déportation), il a déjà eu un avc et un infarctus. Il a une tension très élevée que les médicaments ne font pas baisser. Il sait qu’il risque un nouvel avc qui peut le laisser très handicapé, chose qu’il ne supporte pas. Même si je ne saurais résumer son suicide en ces quelques lignes, il est certain que tout cela a joué dans le fait de se suicider le 13 mai 1998.
Il a donc fait exactement ce que vous proposiez Madame Lefebvre.
Mais.
Se suicider implique de choisir une méthode efficace et de n’être pas « dérangé » pour le compléter. Mon père a été découvert avant qu’il soit définitivement mort, si j’ose m’exprimer ainsi. Imaginez-vous Madame, le choc que cela a été pour celle qui l’a découvert ? C’est bien beau de conseiller aux gens le suicide mais soyons un peu pratiques. Comment procède-t-on ? Se suicider implique que votre corps soit découvert ; il faut donc le faire dans un lieu public avec tout ce que cela implique de traumatismes pour les gens qui assisteront à l’acte ou découvriront le corps ou chez soi en espérant que vos proches vous découvrent rapidement. Mon père s'est suicidé et puis il est mort ; tout cela en deux temps. En deux traumatismes.
Voyez-vous Madame Lefebvre je suis une personne extrêmement pratique. Lorsque ma mère m’a dit vouloir se suicider lorsqu’elle souffrirait trop (elle avait un cancer du pancréas), j’ai commencé à réfléchir comment organiser tout cela. I fallait bien que quelqu’un la trouve (et cela ne pouvait être que moi) et ce rapidement (histoire d’éviter une vision de son corps très dégradé). Cela impliquait donc par exemple que ma mère me dise qu’elle se suiciderait le 8 avril, que je passe donc la journée avec cette vision en tête, que, le 9, je débarque gaillardement chez elle pour découvrir son corps et que je prévienne la police et un médecin. Parfait pour faire un deuil, je vous assure.
Mais revenons-en à mon père puisqu’il a pris, selon vous, Madame, la seule décision à adopter face à son état.
Vous aurez déjà compris donc qu’il n’est pas mort tout de suite mais le lendemain avec ce que cela peut susciter d’horreurs pour sa famille, celle qui l’a découvert, ceux qui l’aimaient. Avec a vision de son suicide gravé sur son corps et visible pour nous. Avec l’espoir qu’il va peut-être se réveiller, que le cerveau n’est pas tout à fait mort. Avec l’espoir qu’il va mourir parce que s’il reste dans cet état pendant des années, c’est tout aussi épouvantable. Avec l’idée qui me hante de ne pas savoir la date exacte de sa mort, était-il médicalement mort le 13 ou est-il mort le 14 lorsque son cœur s’est arrêté ? Est-ce que c’est l’acte de décès qui dit la mort ?
Beaucoup de suicides ne sont pas complétés, Madame, quel joie et quel bonheur pour le malade et sa famille de passer à « j’ai une maladie incurable » à « j’ai une maladie incurable et je suis tétraplégique ».
Pouvez-vous imaginer Madame, ce que devient la vie de la famille lorsqu’un de ses membres se suicide ? qu’il ait ou non une « bonne » raison pour le faire ? Comme je l’ai dit, je suis en profond doute face au suicide assisté mais il n’est en rien ressemblant au suicide (voilà pourquoi je préférerais l’appeler euthanasie, d’abord parce que j’ai du mal à écrire le mot « suicide » et ensuite parce qu’il n’y a pas, me semble-t-il dans l’euthanasie, la violence symbolique qu’il y a dans le suicide). Il faut ne jamais avoir vécu de suicide pour comparer les deux, vraiment.
Je ne parlerais que pour moi mais j’ai passé les 20 dernières années à me demander ce que j’aurais pu faire différemment pour que mon père ne passe pas à l’acte, n’accomplisse pas un acte aussi violent, acte que j’ai pris et continue à prendre pour un crachat dans ma figure et celle de ma mère.
Lorsqu’un de vos proches se suicide, Madame, y compris s’il a une maladie incurable, vous serez la coupable de ne pas l’avoir sauvé. Je l’ai vécu, ma mère l’a vécu. On cherchera à savoir où vous étiez, ce que vous lui avez fait ou pas fait.
Lorsqu’un de vos proches se suicide, le suicide devient une de vos options lorsque vous allez mal. J’ai passé les six mois suivant le suicide de mon père à me demander quand je passerais à l’acte à mon tour, persuadée que j’avais désormais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et le fait est qu’à chaque fois que c’est allé mal dans ma vie, cet hypothèse a été présente alors qu’elle ne l’avait jamais été. Les statistiques le démontrent, il y a plus de suicides chez les familles où quelqu’un s’est suicidé que dans les autres.
Ma mère a finalement fait le choix de ne pas se suicider (très égoïstement, cela m’a soulagée, deux parents suicidés, on finit par se dire qu’on a merdé quelque part) et est morte de son cancer, de manière extrêmement douloureuse. Mieux ? Je ne saurais dire. Je peux simplement vous dire que cette mort, n’a en termes de violence, rien à voir avec celle de mon père qui m’a laissé amertume, colère, fureur et haine.
Je reste stupéfaite qu'un débat aussi difficile soit mené par des gens n'y connaissant d'évidence rien, instrumentalisant sans vergogne les malades pour mieux étaler leur ignorance crasse et dangereuse sur le suicide.
"The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world".
Edgar Allan Poe
Hier, une personne m’a dit que ma mère était très belle sur la photo que j’avais jointe au texte parlant de sa mort. Ce n’est pas la première à le faire et je voudrais interroger cette phrase.
Comme de nombreuse femmes, ma mère a passé sa vie au régime, je sais qu’au début de son cancer du pancréas elle était contente d’avoir perdu autant de poids, grâce au cancer. La grand-mère d’un ami qui avait elle aussi lutté toute sa vie pour maigrir était très fière à 90 ans d’être devenue si mince… là encore à cause d’un cancer. C’est un constat terrible parce que toutes deux avaient conscience de la faiblesse extrême que ce poids perdu leur avait causé, ma mère savait qu’elle mourrait de ce cancer mais elle ne pouvait s’empêcher d’en être heureuse.
Ma mère voulait être mince à cause de tous les hommes de sa vie, dont mon père, qui de remarque en humiliation répétées, ne lui ont conféré de la valeur qu’avec un poids inférieur à 55 kilos.
Ma mère a passé sa vie sur des talons hauts qui lui ont tellement abimé les pieds, qu’elle ne rentrait plus dans aucune paire de chaussure à la fin de sa vie et qu’elle avait des douleurs atroces qui l’empêchaient de marcher.
Lorsque j’ai commencé à parler d’euthanasie, je me suis demandée pourquoi les associations pro euthanasie avaient choisi comme « slogan » le « droit de mourir dans la dignité ». Je me demandais ce qu’on appelait dignité, qui est un concept très genré. La dignité des femmes n’est pas celle des hommes, on considère vite qu’une femme est indigne si elle a couché avec des hommes par exemple. On jugera peu digne une femme qui pleure de douleur en la jugeant "hystérique" et "peu viril" un homme qui fait de même. Les attentes en terme de dignité existent pour les hommes et les femmes mais elles sont différentes. Et l’idée de dignité me semble un concept très validiste.
Quelques jours avant de mourir, ma mère a voulu aller aux toilettes refusant une énième fois les toilettes portatives, parce que cela l’obligeait à ensuite aller vider le seau puisqu’elle refusait que je le fasse. Trop faible, elle s’est retrouvée coincée dans la cuvette et c’est mon compagnon qui, au matin, a dû la lever. Je pensais à ma mère pleurant d’humiliation après cet épisode. Je me demandais quel monde nous avons donc construit, pour qu’une femme fatiguée, se sente humiliée de devoir être levée des toilettes alors qu’il s’agit d’un non-évènement si on y réfléchit. Personne n’a à être humilié de devoir être aidé et assisté.
Est-ce que c’est indigne d’être aidée aux toilettes ? Ma mère voulait mourir après cet épisode, ou d’autres similaires. Est-ce qu’elle était belle coincée sur sa cuvette ? Je passe d’autres épisodes, parce que ma mère serait déjà furieuse que je vous raconte tout cela, mais je pensais à tout cela hier en lisant cette personne me dire que ma mère était belle. Et je ne comprends toujours pas, vraiment. Si on estime le physique d’une femme mourante, alors quid des femmes qui ne le sont pas ? Qu’est ce qui est exigé d’elles ? Je repasse dans ma tête le feuilleton des mois de lutte de ma mère contre cette maladie de merde si dévastatrice, si douloureuse et dont une inconnue retient qu’elle était « belle trois semaines avant sa mort. »
Je pense à ses derniers mots « aide moi » (et je n’ai pu le faire) où son visage était déformée par la terreur et la douleur. Et non ma mère n’était pas belle, elle était hideuse et c’est ok.
Je n’ai pas posté la photo de ma mère pour qu’on commente son physique ou la qualité de la photo. J’ai posté cette photo pour l’affronter (parce que c’est une photo difficile à affronter pour moi et que je suis le genre de personne qui se tape sur le pied avec un marteau voir si cela fait mal) et parce qu’il faut montrer que ce que fait la maladie, ce qu’elle enlève. Ma mère quand elle me l’a envoyé m’avait dit « je ne suis pas trop moche ? » et cela me tuait littéralement qu’aussi proche de la mort elle pense encore à cela, comme plein d’autres femmes et comme cela m’arrivera sans nul doute également.
Ce n’est pas neutre que notre premier réflexe, face à n’importe quelle photo de femme, soit de commenter son physique, sa tenue, sa dignité. Nous devrions nous foutre de nous tenir, d’être beaux ou moches, dignes ou indignes.
Dans un monde sexiste comme le nôtre, la dignité des femmes est beaucoup associée à leurs efforts pour tenter de rester jolies ou au moins pas trop moches. On demandera à celles considérées comme laides de faire des efforts pour montrer qu’elles ne sont pas contentes de l’être. On demandera aux jolies de le rester et d’aller se planquer lorsqu’elles ont le mauvais goût de vieillir. Je lis beaucoup, sur les RS, l’idée de « glow up » ; ces femmes ordinaires qui ont eu le bon goût de souffrir et dépenser des fortunes pour devenir plus jolies. J’étais chaque fois frappée quand j’allais voir ma mère à l’hosto du nombre de consultations pour apprendre à nouer son turban, se maquiller, manucure qui étaient proposées… évidemment uniquement aux femmes. Je n’ai évidemment rien contre mais c’est étonnant de se dire qu’une femme, alors qu’elle est en train de lutter contre un cancer, soit dans l’injonction de soigner et préserver sa féminité.
Quand ma mère est morte, j‘ai longtemps regardé son cadavre. J’avais déjà fait de même avec celui de mon père ; je sais qu’un cadavre est un cadavre, dans la quasi-minute, il a l’air de ce qu’il est. C’est moche dans le sens où c’est l’inconnu ; c’est faux à mon avis de prétendre qu’il reste quoi que ce soit de la personne qu’on a connue dans ce truc-là. Je disais dans mon texte précédent regretter qu’on ne pratique pas la toilette mortuaire chez les athées ; j’aurais voulu le faire pour m’approprier cette chair-là devant moi qui est tellement, tellement impressionnant.
Hier je rigolais toute seule en me demandant si le fait d’avoir été belle avant de mourir avait fait d’elle un beau cadavre.
Comme je le disais, la dignité des femmes est profondément associée à leur physique. On louera la femme âgée percluse d’arthrose, qui se fait encore son brushing, on louera la mourante qui a la coquetterie de cacher sa pompe à morphine derrière un foulard. Jusqu’à la fin, on ne nous laisse pas la paix, de crever vieilles et moches, dans notre merde et tout serait ok pour autant.
On ne pardonne pas à Corinne Masiero de se foutre d'être moche ; elle aurait le droit de l'être si elle battait sa coulpe, si elle se cachait, si elle tentait de "s'arranger un peu". Même celles et ceux qui la soutiennent éprouvent le besoin de noter son corps, comme si c'était grave d'être belle ou pas, et qu'il fallait à tout prix la valider.
Merci de m’avoir lue.
Ils sont stupéfaits. Ils ouvrent leur grands yeux d’enfants innocents, entre eux, partout, pour s’étonner qu’on ne puisse plus bien rigoler comme ils disent.
On les connait, on les a subis, ceux qui regardent leurs potes, qu’ils aient 12, 17, 25 ou 50 ans et se jettent sur vous, vous embrassant de force.
Le pire est que vous n’êtes même pas assez importante pour que votre consentement compte ou pas. Ils regardent leurs potes en vous embrassent, en vous tripotant, en vous agressant parce que vous ne valez pas mieux qu’un objet transitionnel entre mecs, pour passer un bon moment entre mecs, pour rigoler entre mecs.
On ne peut plus rigoler disent-ils. C’est vrai qu’on a rigolé. J’ai rigolé des agressions subies « haha il est trop con Sébastien », la gerbe à la bouche.
Une femme ne gagne jamais. Elle est furieuse ? C’est une connasse coincée. Elle rit ? C’est une salope.
Depuis le plus jeune âge, on vous explique que les garçons sont comme ça. C’est bête les garçons, ca agresse, ca tape, ca embrasse, ca palpe, ca insère sa bite de force mais c’est comme ca, ils nous aiment bien tu sais.
Et puis tu vas pas tout gâcher.
Et puis les agressions se multiplient, les moins graves sont toujours devant tout le monde. Avec tout le monde qui rit ; les mec parce que c’est drôle, les filles parce qu’elles y échappent. T’as déjà été vécu un moment compliqué et tu voudrais en plus « gâcher l’ambiance » ?
Ton agresseur compte plus que toi à peu près partout. On ne l’aime pas malgré le fait qu’il soit lourd avec les femmes comme on dit mais parce qu’il l’est. Parce que c’est fameusement drôle de voir toutes ces femmes hyper gênées, qui feignent d’avoir trouvé ca marrant alors qu’on sait bien qu’on les a ridiculisées. C’est ca la magie d’une agression sexuelle ; ridiculiser la victime. Elle chiale ; elle en fait trop. Elle rit ; ca prouve bien que ca n’était pas une agression. Circulez il n’y a rien à voir.
Et puis là d’un coup on ne pourrait plus agresser. Rectifions. On ne pourrait plus nier avoir agressé. Alors on assume, on flamboie, on évoque la tradition, le bon vieux temps, les soirées entre potes, tous les mecs sont renvoyés à une connivence de fait puisqu’ils ont a minima observé, rigolards ou gênés sans réagir.
Ils sont gênés. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent vraiment pas. On a toujours fait ça disent ils. On rigolait bien. Leur « on » n’inclut jamais que les mecs. Les femmes ne comptent pas, à peu près autant qu’un ballon de foot ; on tape dedans mais on ne va pas demander s’il aime ça.
Les journalistes ne cessent de me demander « alors c’est bien ca a changé depuis #metoo ». Oui ca a changé puisqu’on a un homme accusé de deux viols au ministère de l’intérieur.
Ca a changé puisqu’on démissionne pour du homard mais pas pour un viol.
Ca a changé puisque désormais des hommes peuvent assumer avoir agressé en plein plateau télé et se plaindre de ne plus pouvoir le faire.
Ca a changé puisqu’on en appelle à la connivence virile pour être soutenu.
Ils sont stupéfaits. Comment mais le féminisme incluait aussi le fait de ne plus rigoler ? C’est leur nouveau terme ça. Une bonne rigolade is the new agression sexuelle. On convoque les victimes sur les plateaux ? Non mais vous vous en foutiez à l’époque leur demande t on, donc pourquoi ce drame.
Mais mes braves garçons, heureusement qu’on a mis en place de stratégies mentales pour ne pas être traumatisées à chacune de vos bouches/mains/pénis sinon on serait toutes dans le trou. Heureusement qu’on a relativisé, mis notre mouchoir par-dessus ; ca nous a protégées. Et pas que du traumatisme, on a évité de perdre nos carrières, notre vie, nos amis, notre réputation.
On n’a pas rien dit parce qu’on trouvait ca drôle ou qu’on vous appréciait mais qu’on s’appréciait suffisamment assez pour savoir qu’on allait davantage y perdre.
On en pointe un du doigt, il s'en cache 5000.
C’est qu’on en met en place des stratégies de survie ; j’exagère, il est sympa, les autres l’aiment bien, il est mon mari, je vais gêner ma famille, et les enfants alors, et puis c’est que de l’humour, je prends tout mal aussi, c’est mon supérieur, tout le monde l’apprécie, je ne suis rien, c’est juste une bouche, un doigt, une bite, t’en as connu d’autre, Darmanin à l’intérieur à quoi bon.
Backlash partout.
Vous trouverez ici mon premier article définissant le terme féminicide.
Je suis partie du constat suivant : les media français se sont rapidement emparés du terme de féminicide alors qu’a contrario ils peinent toujours à simplement décrire des violences sexuelles, qui sont souvent décrites sous forme de périphrases (« le père entra dans la chambre et referma la porte » pour qualifier un inceste par exemple).
Lorsque nous, féministes, interpellons les media pour des formulations que nous jugerons hasardeuses, nous sommes souvent renvoyées qu’ils seraient journalistes (et donc objectifs) alors que nous serions militantes (et donc par essence subjectives). Au-delà du vieux débat sur l’impossible objectivité journalistique (traiter ou ne pas traiter une information est déjà de la subjectivité), je me suis donc étonnée que l’emploi d’un terme profondément militant comme « féminicide » ne leur pose pas de problème alors qu’une simple description de violences sexuelles était beaucoup plus difficile à obtenir.
J’ai donc essayé de comprendre ce qui se jouait dans l’appropriation journalistique du terme de féminicide.
Le terme de féminicide n’est pas un terme simple et qui à la fois un outil descriptif mais aussi militant. Revenons au terme qui a servi à le penser, celui de génocide. Lorsque le juriste Raphael Lemkin crée le terme de génocide, il souhaite à la fois qu’un terme existe pour nommer ce qu’il se passe (le massacre organisé et planifié de la population juive d’Europe) et qu’on puisse un jour utiliser ce terme pour juger ce qu’il s’est passé puisqu’une justice internationale humanitaire est en train de se mettre en place. Le terme « crime de masse » existe déjà à l’époque et on pouvait objecter qu’on allait créer deux types de crimes (génocide et crime de masse) comme si l’un était plus grave que l’autre. Lemkin va œuvrer pour que le terme de génocide apparaisse dans les instances internationales. A Nuremberg on lui préfèrera le terme de « crime contre l’humanité » mais Lemkin réussira à ce que le terme soit utilisé par l’ONU dans sa résolution de 1946. Vous trouverez ici le résumé de la controverse entre Lemkin et Lauterpacht sur le terme de génocide qui permet de comprendre en quoi le terme de génocide n’est pas qu’un simple outil descriptif mais aussi un terme militant (ce qui n’enlève rien, répétons-le à la réalité d’un génocide). On différencie désormais les termes de « crime de masse », de « génocide » et de « crime contre l’humanité » par exemple. Le terme de génocide, s’il est entré dans le langage courant, reste un terme militant puisqu’il passe par la reconnaissance que des crimes de masse ont été commis dans l’intention d’annihiler un peuple tout entier. On peut constater que beaucoup œuvrent à nier le caractère génocidaire (donc massif et prémédité) d’un crime de masse.
Le terme féminicide est né de la réflexion de féministes qui considéraient qu’une femme peut être tuée parce qu’on est une femme et s’est construit en réfléchissant au terme de génocide. Il n’a rien à voir avec les termes infanticide, parricide et régicide qui sont des termes uniquement descriptifs. Le terme féminicide est donc à la fois un terme descriptif (une femme est morte) et militant. Militant parce que les féministes désirent à la fois que
- les raisons de ce meurtre en particulier soient connues
- le féministes estiment que ces raisons s’inscrivent dans une organisation sociale générale nommée patriarcat où les hommes ont tout pouvoir sur le corps et la vie des femmes.
Le féminicide reste très mal compris par beaucoup de gens. En effet si à peu près tout le monde comprend qu’il existe des gens qui en haïssent assez d’autres pour les assassiner en raison de leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur religion (ce qui n’empêchera pas pour autant de nier le caractère raciste ou homophobe d’un assassinat), le féminicide échappe à cette compréhension puisque l’auteur d’un féminicide est un homme hétérosexuel donc censé aimer les femmes. Le terme de féminicide a d’ailleurs suscité des controverses au sein même du mouvement féministe ; la féministe mexicaine Marcela Lagarde a déclaré que pour elle le terme « féminicidio » impliquait qu’il y ait une complicité de l’état et de la police dans l’impunité des auteurs de féminicide. La créatrice du terme Diana Russell s’est opposée à cet ajout. Vous retrouverez ici les raisons qu’elle donne à cette opposition.
Avant de donner une définition simple du terme de féminicide voici les 4 grands types de féminicides définis par l’Organisation Mondiale de la Santé
- le féminicide « intime » ; lorsqu’une femme est tuée par son conjoint ou son ex conjoint parce qu’elle est sortie des stéréotypes de genre et qu’elle a une conduite considérée comme indigne d’une femme respectable. Ce sont l’immense majorité des féminicides en France. Les raisons peuvent être les suivantes ; quitter son mari ou vouloir le faire (ou qu’il le croit), s’habiller d’une manière qu’il va juger inappropriée, faire des tâches dites féminines (ménage, cuisine etc) d’une manière qu’il va juger mauvaise.
- le crime « d’honneur ». Une femme peut être tuée lorsqu’elle transgresse des traditions (adultère, être violée, grossesse hors mariage, relations sexuelles hors mariage, fréquenter un homme d’une communauté jugée indésirable etc).
- le féminicide lié à la dot. Un femme dans certains pays doit apporter des biens matériels à la famille de son mari lors du mariage. Des conflits peuvent naitre sur le montant de ces biens et conduire à son meurtre.
- le féminicide non intime. Lorsqu’une femme (ou plusieurs) est tuée par un inconnu pour des raisons liées à des stéréotypes de genre
- refuser des relations sexuelles à un inconnu
- estimer que les femmes ruinent la vie des hommes (Marc Lépine à Montréal)
A titre personnel, j’ajouterais à ces types de féminicides, toutes les morts évitables de femmes parce que la vie des femmes n’est pas considérée comme assez précieuse pour être préservée. On pourrait donc considérer comme féminicides, toutes les morts dues aux mutilations sexuelles féminines, aux accouchements dus à une grossesse trop précoce, aux accouchements dans des conditions d’aseptie insuffisantes alors que le pays a la possibilité d’offrir aux femmes des conditions correctes etc.
Le féminicide est donc le fait de tuer une femme parce qu’elle sort des stéréotypes de genre et ne se comporte pas comme une femme devrait se comporter. On peut y rajouter, pour le cas des féminicides liées à la dot, que certaines féminicides sont liés au fait que l’existence d’une femme est en tant que telle un problème (parce qu’elle va couter cher donc on l’élimine à la naissance, parce qu’elle n’apporte pas assez d’argent lors d’un mariage etc).
Croire qu’il existe des féminicides est donc croire qu’il existe des stéréotype des genre et qu’on peut tuer lorsqu’ils ne sont pas respectés. C’est donc je le répète un terme qui oblige à adhérer à pas mal de théories féministes, j’ai donc été assez surprise de voir l’engouement des media pour ce terme.
En janvier 2021 Jean-Marc Reiser déjà condamné pour des viols (et mis en examen mais acquitté pour la disparition d’une femme) reconnait avoir tué une étudiante Sophie Le Tan. Il dit l’avoir fait car elle a refusé de coucher avec lui. Cette raison marque clairement qu’il s’agit très probablement d’un féminicide ; Reiser estime que les femmes ont des devoirs envers lui et doivent se comporter d’une certaine manière. Il les viole/les tue lorsqu’elles ne le font pas. Je n’ai trouvé aucun journal qui parle de féminicide. On pourrait arguer que les journaux attendent le procès pour se faire mais cette précaution là n’est pas prise lorsqu’il s’agit d’une femme tuée par son conjoint ou ex conjoint.
Toujours en janvier, nous apprenons que le tueur en série Jacques Rançon sera jugé en juin pour le viol et le meurtre de Isabelle Mesnage. Rançon a déjà été condamné pour des viols, meurtres et tentative de viol sur plusieurs femmes. Les raisons de son passage à l’acte sont connues ; il demande à des femmes inconnues de coucher avec lui, elles refusent et il les viole et/ou les tue. Là encore le terme de féminicide n’a pas été employé pour décrire ses actes.
Si nous recherchons des affaire où les auteurs étaient inconnus des victimes ; Elodie Kulik, Laetitia Perrais Victorine Dartois etc le terme de féminicide n’est quasiment jamais employé.
Je me suis alors rendue compte que le terme de féminicide était désormais employé dans la presse comme un terme descriptif pour qualifier le meurtre d’une femme par son conjoint ou son ex conjoint. Or il existe un terme précis pour définir cet acte ; uxoricide.
Pire je me suis rendue compte que certains media, l’AFP en tête, avait décidé de leurs propres règles pour comptabiliser les féminicides. D’emblée il a été décidé de ne comptabiliser que les meurtres par conjoints. On pourrait arguer qu’ils constituent l’immense majorité des féminicide mais ils n’en constituent pas la totalité qui plus est cela participe à vider de sa substance le terme féminicide. Je lis ainsi « l’enquête a montré que la femme et son meurtrier n’ont jamais eu de relation intime ». Cela vise donc à écarter toutes les femmes tuées par des hommes inconnus ; ou si les termes « relations intimes » implique une relation amoureuse/sexuelle, toutes celles n’ayant aucune relation de cette sorte avec leur meurtrier. D’autres media ont écarté les meurtres où la victime était malade et où par exemple le meurtrier s’est suicidé ensuite. Chez les auteurs masculins, la tranche d’âge la plus représentée dans les meurtres par conjoint, est 70 ans et plus. Leur premier motif est la maladie et la vieillesse de l’autre. L’immense majorité des aidants familiaux sont des femmes et pourtant cela conduit à peu d’homicides. Il y a donc sans nul doute une dimension genrée dans le fait de supporter ou non la maladie de l’autre et d’y mettre fin par le meurtre ou l’assassinat. Et nier les raisons sexistes qui ont précédé ce meurtre conduit au non emploi du terme féminicide.
Le terme féminicide est désormais employé par tous les media français mais il a été vidé de sa substance militante pour devenir un simple outil descriptif ; le meurtre d’une femme par son conjoint ou son ex conjoint. Se faisant les media oublient opportunément de décrire les mécanismes structurels qui conduisent au féminicide et plus précisément au féminicide conjugal.
Cette dépolitisation du terme « féminicide » participe au féminismwashing de bon nombre de media, qui entre deux enquêtes sur les féminicides, peuvent se sentir autorisés à publier des lettres de violeurs et des tribunes masculinistes. Pire cela sert indirectement le gouvernement et sa (absence de) politique en la matière. En réduisant le nombre de féminicides à peau de chagrin, on peut aisément en conclure que les trois mesurettes sans ambition adoptées portent leurs fruits.
Si nous pouvions nous réjouir qu’il ait désormais remplacé le fameux « crime passionnel », nous devons pour autant rester vigilantes à ce qu’il ne devienne par un simple outil descriptif. Un féminicide n’est pas que le meurtre d’une femme par son conjoint ; il décrit également tout le mécanisme d’appropriation des femmes par les hommes, dans le patriarcat, nommé hétérosexualité, qui les conduit à avoir droit de vie et de mort sur elles (et vous comprendrez au vu de la levée de boucliers que ne va pas manquer de susciter cette dernière phrase) qu’il est curieux que les media se soient emparés d’un terme aussi fort que féminicide.
Ce texte comprend des descriptions explicites de violences sexuelles sur enfants.
- Tu aimes ce chanteur ?
- Non
- Pourquoi donc ?
- Parce que quand j'étais petit, mon père m'a dit que ce chanteur aimait les petits garçons.
"Aimer les petits garçons."
C'est ainsi que ma réflexion a commencé au détour de cette conversation anodine.
Vous qui me lisez, je sais que vous comprenez tous et toutes, cette périphrase. Vous savez qu'on ne parle pas de quelqu'un qui aime la compagnie des enfants pour jouer avec eux. Vous savez qu'on ne dira jamais d'un homme qui aime passer du temps avec les enfants qu'il "aime les petits garçons".
Alors on va évidemment tous mettre un sens différent derrière cette expression. Est-ce qu'on soupçonne qu'il pourrait violer des enfants ? Est ce qu'il le fait régulièrement ? (et si on le sait tous, pourquoi ne se passe-t-il rien contre lui ?) Est ce qu'il les agresse sexuellement ? ("tripoter les enfants" est encore un autre euphémisme couramment employé)
Nous sommes nombreux à avoir été prévenus contre ces hommes qui "aiment un peu trop les enfants". Ils les "tripotent", il faut "faire attention".
Mais on ne nous a jamais dit à quoi il faut faire attention. On ne nous dit jamais ce que veut dire "aimer trop les enfants".
On me rétorquera qu'on va pas pas être explicite à un gamin et qu'on ne va pas lui expliquer que le monsieur Bizarre rêve de lui mettre son pénis dans la bouche.
Bien évidemment. Pourtant nous ne minorons pas les dangers que peut vivre un gamin.
"regarde avant de traverser sinon tu vas te faire écraser" (le mot écraser est sans aucune équivoque)
"ne joue pas avec les allumettes, tu vas te brûler"
"ne mets pas tes mains sur la porte tu risques de te faire pincer très fort" (autocollant dans le métro parisien, qui certes euphémise la blessure possible mais reste quand même très clair).
Il y aurait sans doute mille et une façons de prévenir les enfants des dangers des criminels sexuels, même si je considère en soi comme problématique de confier à un enfant sa propre sécurité sexuelle, parce que cela signifie que nous abandonnons aux enfants le soin de prendre soin d'eux, et pire qu'il suffirait qu'un enfant dise non à un violeur pour que celui-ci cesse immédiatement.
Et pour prévenir les enfants face aux criminels sexuels, nous avons choisi de leur dire que ces derniers "aiment les enfants".
Quelle curieuse idée.
Alors évidemment c'est en droite ligne de ce qu'on peut lire de certains criminels sexuels adultes ; "DSK l'homme qui aimait trop les femmes", "DSK séducteur jusqu'à l'inconscience". Mais il y a une forme de logique ; lorsqu'on ne comprend rien aux violences sexuelles - ou qu'on cherche à dédouaner un violeur - on va chercher à faire croire que tout cela n'est qu'un gigantesque malentendu et que là où on croit qu'il y a violences, il y a simplement un homme trop impétueux.
Mais cette possibilité n'existe pas avec un violeur d'enfants ; il n'existe pas de contexte où un adulte peut avoir des relations sexuelles consenties avec un enfant ; il n'existe qu'un contexte de viol et peu importe que l'agresseur soit ou non physiquement violent. Et qui plus est les personnes qui définissent les violeurs d'enfants comme des hommes aimant trop les enfants, ne cherchent pas à les dédouaner par cette expression.
Comment en ce cas peut-on résumer le violences sexuelles sur enfants, au fait de "les aimer" ou "trop les aimer".
Je me souviens d'une autre conversation avec quelqu'un qui était ami avec un pédocriminel condamné. Comme je n'arrivais pas à comprendre, j'ai fini par lui dire : "oui enfin le fait est que tu es ami avec quelqu'un qui a branlé des gamins de 9 ans".
J'ai vu - et cela n'était pas une interprétation de ma part - que la question ne s'était jamais posée en ces termes pour lui. Qu'il n'avait pas vraiment conceptualisé ce que veut dire que d'agresser sexuellement des enfants. Nous sommes capables de conceptualiser un meurtre, un viol d'adultes sans doute, mais la majorité d'entre nous (tout au moins celles et ceux qui ne l'ont pas vécu) ne voulons pas imaginer ce que fait un violeur ou un agresseur d'enfant.
Le tabou est si fort dans notre société que nous n'arrivons même pas à en parler simplement. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué ; lorsque je suis confrontée dans ma pratique professionnelle (je suis modératrice de contenus sur Internet) à de la pédocriminalité et que je souhaite en parler, par exemple pour me soulager un peu, les gens me disent de m'arrêter. Cette réaction sera différente si je parle de morts par exemple, ils n'hésiteront souvent pas à me demander des détails sordides.
Je ne suis évidemment pas en train de dire qu'on devrait tous se mettre à imaginer ce qu'est un viol d'enfants. Mais comment peut-on sereinement réfléchir sur le sujet si nous sommes dans l'incapacité d'y penser, que la simple évocation du terme "pédophilie" provoque chez tout le monde (y compris les personnes qui n'en ont pas été victimes) de l'angoisse et de la colère incontrôlable.
J'ai été frappée ces dernières semaines par la prise de parole de Castex (dans l'émission de télé C'est à vous) et de Macron (dans un twit). Tous deux étaient incapable de parler de viol ou d'inceste alors que c'était le sujet.
Dans le cas de Macron, son discours a été abondamment préparé et validé par plusieurs dizaines de personnes, c'est donc encore plus surprenant. Ils ont usé de périphrases, de circonvolutions mais les termes n'ont pas été dits.
J'ai constaté la même chose dans l'article de Ariane Chemin. Voici comment sont décrits les viols : "Dans une famille d’intellectuels parisiens, un garçon de 13 ans voit son beau-père, universitaire de renom, s’inviter le soir dans sa chambre."
Il faut attendre un bon moment dans l'article pour que le mot "fellation" soit prononcée alors qu'il s'agit pourtant (et les journalistes ne cessent, face à nous féministes, de dire qu'ils veulent des "faits" et pas du "militantisme") uniquement de décrire des faits, chose que Camille Kouchner a fait dans son livre. Qu'est ce qui bloque au point qu'on ne puisse simplement décrire un viol ? (ce qui a un intérêt autre que descriptif, des personnes ayant subi des actes similaires peuvent ainsi comprendre que ce sont des faits de viol par exemple).
Je m'étais élevée, l'an denier, contre la publication des extraits des écrits de Matzneff. J'avais plusieurs raison à cela :
- de pas accorder foi au récit d'un pédocriminel ; Matzneff fait une construction littéraire de ce qu'il a fait. Ce n'est pas une déposition de police ; c'est une œuvre littéraire avec des reconstructions, des oublis, des figures de style.
- de ne pas donner un rôle central à Matzneff qui jouit, sans nul doute qu'on lui apporte autant d'attention. C'est quand même une drôle de vision de la société de croire les victimes seulement après avoir lu la mauvaise prose de l'auteur.
- le récit brut de viols d'enfants, dans une ambiance sur-échauffée, ne permet pas de réfléchir sereinement à la lutte contre la pédocriminalité. On sait même que cela peut avoir un effet contreproductif ; les gens sont tellement horrifiés qu'ils sont se boucher yeux et oreilles parce que cela leur est insupportable.
Mais c'est bien autre chose lorsque des medias, des politiques, nous tous et toutes devons parler de violences sexuelles.
Il ne s'agit pas de tomber dans le récit sordide et voyeuriste de violences sexuelles.
Mais il s'agit de les nommer.
Comme pouvons nous faire confiance à des politiques qui nous disent qu'ils vont mener une lutte sans relâche contre les criminels sexuels alors que le mot "viol" semble les effrayer ?
Comment croire les media qui nous disent faire attention à leur vocabulaire alors que le récit de violences sexuelles est toujours la démonstration qu'ils maitrisent toutes les figures de style existantes mais sont incapables de faire un simple récit factuel ?
Selon l'excellent terme d'une amie, il faut cesser de démoniser les violeurs d'enfants et le viol d'enfant. Les violeurs d'enfants sont, selon toutes les études qui leur sont consacrées, des hommes lambda, bien insérés, sans pathologie mentale particulière. Ils appartiennent à toutes les classes sociales, religions, origines géographiques. Leur seul point commun est d'être extraordinairement majoritairement des hommes.
Nous ne pourrons parler d'eux et des crimes qu'ils commettent si nous continuons à les voir comme des "monstres", des démons", des "diables".
L'immense difficulté est d'arriver à faire comprendre qu'on peut commettre des crimes jugés comme monstrueux (même si j'ai la plus grande réticence à employer ce terme qui me semble engluer la victime dans une toile) sans être un monstre.
J'ai tristement constaté ces jours derniers à travers les réseaux sociaux, que le tabou de la pédocriminalité est si grand, qu'en parler véritablement provoque une horreur si grande qu'elle va ensuite légitimer des idées fascistes (comme par exemple l'idée de faire placarder a tête du violeur partout, ou de faire de tout violeur présumé, un coupable qui devrait prouver son innocence au mépris du droit le plus élémentaire).
Ce n'est pas la première fois que nous le constatons : lorsque des crimes sur enfants sont particulièrement médiatisés - et que pour des raisons pas toujours logiques (pourquoi tel viol plutôt que tel autre qui ne suscite qu'indifférence) la population s'y intéresse massivement, la réaction est toujours la même ; demander plus de prison, moins de droits. L'horreur du criminel sexuel est telle que nous sommes massivement prêts à sacrifier nos libertés pour lutter contre lui (ce qui est doublement stupide car si on pouvait lutter contre le viol par l'unique sanction judiciaire, ca se saurait depuis longtemps). Je tiens à ce sujet à rappeler l'hystérie absolue qu'a connue la Belgique après l'affaire Dutroux qui n'a entrainé aucune amélioration concrète en matière de lutte contre la pédocriminalité.
La lutte contre les violences sexuelles, en particulier contre les enfants, mérite mieux que des décisions hâtivement prises. Les politiques doivent, s'ils ont réellement l'intention de mettre en place des mesures (et non pas d'empiler des lois inapplicables, qui ne coûtent pas un rond) en parler sereinement, sans tabou.
En 2003, sortait Lucky de Alice Sebold. Elle y racontait le viol qu’elle avait subi et ce qui en avait découlé. « Lucky » parce que lorsqu’elle avait porté plainte, les flics lui avaient dit qu’elle avait au fond de la chance car la dernière à avoir été violée à cet endroit-là avait aussi été coupée en morceaux.
Je me souviens, lorsque je lisais le récit du viol, que je la trouvais chanceuse moi aussi. Je me disais qu’avec un viol pareil (elle était vierge, c’était un inconnu, il avait un couteau, il l’a massacrée de coups des poings et le viol en lui-même était physiquement très brutal), elle serait soutenue. Quelle naïveté ; son père s’est indigné qu’elle ne se soit pas davantage débattue lorsque le violeur a lâché son couteau et sa mère lui a dit qu’il valait mieux que cela arrive à elle, qu’à sa sœur, qui ne l’aurait pas supporté.
Mais je me disais qu’Alice Sebold était la bonne victime, celle qu’on croit et qu’on plaint.
Dans un viol il faut deux partenaires ; un bon violeur, qui correspond à tous les stéréotypes sur le sujet et une bonne victime. C’est un jeu où il faut cocher toutes les cases pour espérer un peu de soutien. J’avais tort, il n’existe aucune bonne victime, sauf si elle a eu le bon goût de mourir pendant l’agression. On adore les victimes mortes, on peut les parer de toutes les vertus et surtout elles sont silencieuses, elles n’emmerdent personne avec leurs traumas, leur féminisme.
J’ai attendu que ma mère meure pour témoigner d’un des viols que j’ai subis, en 1992 parce que notre relation face à ce qui m’est arrivé était trop complexe pour que je le fasse de son vivant. Même si elle m’a enfin crue en décembre 2019, je sais qu’elle n’aurait pas aimé que « je parle de ces choses-là » et pour une fois je lui ai fait ce plaisir.
Sans doute y-avait-il un peu de lâcheté de ma part aussi parce que je sais qu’en racontant ce viol, je perds de ma qualité de témoin impartial qui peut parler des violences sexuelles (à peu près impartial, je ne suis qu'une femme). On associera désormais mes propos à mes traumas, mon passé, un passif psychiatrique ou que sais-je.
Mais je considère qu’il est important de témoigner si l’on a un petit impact médiatique. Déjà il est arrivé assez souvent que des très jeunes femmes me contactent pour parler des violences sexuelles qu’elles avaient subies en me disant qu’elles savaient que moi je ne me « serais pas laissée faire ».
Parce que témoigner que ce que vous avez vécu est un viol (même si c’est mon cas puisqu’il est stéréotypé c’est assez facile de le comprendre) aide les jeunes femmes qui ont été, sont ou seront victimes du même type de viol, à le savoir.
Ensuite je veux interroger cette notion de courage entourée au fait de témoigner. Si je parle de mon agression en 2001 avec un scalpel sous le gorge, pour de l’argent, vous ne trouverez pas courageux que je témoigne. Si je dis avoir insulté un skin head en 1992, qui m’a tabassée ensuite, vous ne me trouverez pas courageuse. Pourquoi serait-il courageux de témoigner dans le cas spécifique du viol sauf si vous pensez que c’est honteux de l’avoir été. Associer du courage au fait de témoigner en dit davantage sur le malaise que vous avez à entendre des récits de viol ; l’idée d’un pénis, d’un doigt ou d’un objet introduit dans une bouche, un vagin ou un anus met davantage mal à l’aise que celui d’un couteau dans de la chair. Parce que beaucoup de gens ne trouvent pas courageux qu’on se remémore le viol, puisqu’on le raconte, ca ils s’en contrefoutent mais qu’on expose « ce qui doit rester du domaine privé ».
Il n’y a pas de plainte à déposer ici, pas d’enquête à mener, personne à condamner. Juste je suis une de plus.
Enfin je veux témoigner parce qu’il y a toujours les bonnes et mauvaises victimes, que j’en ai toujours été une mauvaise, y compris parfois au sein des mouvement féministes.
Et, bien évidemment, je ne témoigne pas pour les hug et autres soutiens virtuels qui ne sont pas le sujet face à un propos certes ancré sur un cas individuel mais bien politique.
C’était en 1992, j’avais 18 ans. Ce soir-là pour ceux qui connaissent Lyon, j’étais au fin fond du plateau de la Croix-Rousse chez un mec avec qui je me suis disputée. Je suis donc repartie saoule, défoncée au cannabis, habillée court sexy et transparent à une époque sans uber, sans téléphone portable et sans internet. J’habitais sur la colline de Saint Paul. Presque arrivée un homme m’a sautée dessus, armé d’un couteau. Je ne me suis pas débattue, je ne dirais pas qu’il y avait là une décision consciente, mais je n’étais pas non plus en état de sidération. Je dirais simplement qu’entre être violée et peut-être rester vivante, et être violée et en plus poignardée ou morte, j’ai pris, en un quart de millionième de seconde, l’option 1.
Lorsqu’il est parti, malgré toute l’éducation patriarcale que j’avais reçue, j’étais forte de la conviction inébranlable que ce n’était pas de ma faute ; le couteau et le côté très inquiétant (même si cela peut paraitre surprenant pour un violeur, le fait est que celui-ci était quand même dans son attitude, très particulier) y ont aidé.
Je suis arrivée dans ce commissariat où 3 hommes étaient à l’accueil. Revenaient-ils d’une opération ? Vu l’heure et leur état d’excitation virile c’est bien possible. J’avais l’attitude d’une personne qui a minima a été agressée ; bras abimés, vêtements sales et déchirés. Je me souviens de ce regard goguenard qui m’a toisé de haut en bas. J’ai dit « j’ai été violée ». L’un d’entre eux m’a répondu que s’il avait été mon père il m’aurait mis une paire de claques pour sortir vêtue ainsi. Les comparaisons entre hommes qu’ils adorent pour voir qui a la plus grosse. La violence physique sur « leurs » femmes. Le transfert de responsabilité. Je suis repartie.
J’ai longtemps pensé, parce qu’on en est là, parce que le viol fait partie de la vie collective des femmes, que j’avais eu de la chance. De ce type, mon violeur comme je l’appelle, je n’attendais rien. C’est un inconnu, je peux le qualifier à loisir de psychopathe, ca m’arrange, c’est plus facile que de le penser inscrit dans un monde où les hommes, psychopathes ou non, violent les femmes sous le regard des hommes psychopathes ou non qui détournent les yeux, les applaudissent ou les trouvent par ailleurs vachement sympa alors bon tu comprends ca va rester mon pote. « Et puis qui me dit que tu ne l’as pas provoqué cet homme », me disaient des potes, qui n’avaient d’autre lien que le sacro saint lien viril avec un type qui viole des femmes armé d’un couteau.
Mais j’attendais plus des gens que j’aimais et qui m’aimaient ; j’attendais qu’on rassure cette part infime de moi qui disait « quand même tu auras hurlé peut-être qu’il serait parti ». Peut-être oui. Ou pas. Et on hurle moins bien avec un couteau dans la gorge.
Bien évidemment parce que c’est ce qui arrive à l’immense majorité des victimes de viol ce n’est pas ce qui est arrivé ; personne n’a eu une attitude correcte a minima. Je mentais, j’avais beaucoup d’imagination, je cherchais l’attention, c’était une occasion pour ne pas aller en cours, je faisais mon intéressante.
Je me souviens des moments que j'ai passés à errer dans Lyon à la recherche de mon violeur pour qu'il me confirme que oui j'avais bien été violée puisqu'il était désormais le seul qui allait me croire.
J’ai découvert au fil des années que je n’étais pas également assez traumatisée, y compris au sein des mouvements féministes. On m’a soupçonné de ne pas vouloir voir en face le traumatisme que j’avais forcément (je souffre d’un long traumatisme dû à la déportation de mon père dont je n’arrive pas du tout à me défaire. Après son suicide, j’ai eu une période de six mois de traumatisme très profond suivi d’une dépression de deux ans. A l’heure actuelle j’ai un traumatisme du à l’agonie difficile de ma mère, je pense donc avoir une légère idée de ce qu’est et n’est pas un traumatisme). Et le fait est que je n’ai pas été traumatisée par ce viol ni pas l’autre. Et le fait est que pour beaucoup de gens cela fait de moi une personne dégénérée, une salope qui doit aimer être violée par des hommes avec des couteaux.
Alors je témoigne aussi pour celles-là, celles qui vont bien mais pour qui cela n’enlève rien à la gravité du viol qu’elles ont subi. Celles qui ont ri, bu, fumé sont sorties en robe ras la chatte et qui ont été violées et vous emmerdent qui plus est.
On doit avoir honte d’avoir été violées, on doit se sentir mal d’avoir été violées, on doit avoir un traumatisme (pas trop long ni profond non plus sinon on emmerde tout le monde avec).
Les femmes violées qui parlent sont haïes déjà parce qu’on n’aime pas bien les femmes qui parlent, ensuite parce qu’elles dérangent cet ordre établi où les hommes aiment les femmes dans cette hétérosexualité rose bonbon. A la limite les femmes comme moi auraient pu servir puisqu’on a été violé par des hommes à la marge, le fameux inconnu au grand couteau. Mais non même pas puisqu’on a l’outrecuidance de ne pas s’être suicidé ensuite, de ne pas s’en vouloir une seconde et d’inscrire notre violeur dans la communauté des hommes.
Je ne suis pas en train, bien évidemment, de jeter l’opprobre sur les victimes qui sont traumatisées. Mon livre Une culture du viol à la française est dédiée à deux combattant-e-s, qui luttent contre les traumatismes profonds que leur ont causé leur viol.
Il n’y a pas de bonne victime dans une société patriarcale parce qu’elle dérange la sacrosainte hétérosexualité ; ou l’exploitation des femmes par les hommes est appelée le mariage, où la violence des hommes sur les femmes est appelée passion ou drame familial, où le viol est appelé « sexualité un peu rude » ou « tu l’as quand même bien cherché salope ».
Plus nous témoignons, plus notre nombre croit, plus nous sommes haïes parce qu’il devient très difficile de détourner les yeux en hurlant « c’est pas moi ».
Lorsque je définis la culture du viol je dis que c’est l’ensemble des idées reçues sur le viol, les victimes et les auteurs et que, invariablement ces idées reçues contribuent à déculpabiliser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les viols eux-mêmes. Si je devais resserrer cette définition, je dirais que la culture du viol est la haine profonde, terrible, des femmes violées qui ont le toupet de s’exprimer. De nous déranger dans notre monde confortable où les pères aiment leur fille, les frères leur sœur, les maris leur femme et les inconnus dans la rue toutes les femmes. Chaque témoignage de plus est un clou dans le cœur des hommes, qui ne supportent décidément plus qu’on les embête autant avec nos petits problèmes qui relèvent de la misandrie.
Nous sommes toutes des mauvaises victimes parce que nous reconnaitre victimes légitimes ferait admettre qu’il y a un problème, réel, que ce problème s’appelle la virilité, l’hétérosexualité, l’exploitation.
J’ai beaucoup hésité à écrire sur ce sujet (la maladie de ma mère, son agonie puis sa mort en juillet) et à le publier. Si j’ai l’habitude de prendre la colère comme moteur d’écriture, je ne suis pas sûre que les sentiments qui m’animent aujourd’hui me réussissent tout autant. Je ne suis pas non plus habituée à parler publiquement d’évènements aussi intimes. Mais je me dis que cracher tout cela publiquement me permettra de, peut-être, enfin réussir à dormir au lieu de ressasser ce qu’il s’est passé.
Je me dis également que lorsque j’ai appris la maladie de ma mère et que j’ai cherché à me préparer à sa mort (ce fut un échec), j’aurais voulu (et non pas aimé) lire ce que je vais écrire là. Dans tout ce merdier, si je peux en tirer quelques analyses, si cela peut être utile à quelqu’un, toute cette souffrance n’aura peut-être pas été totalement vaine.
Enfin les articles autour de Alain Cocq ont été l’ultime déclic. Cocq souffre d’une maladie dégénérative très douloureuse. Après le refus de Macron de lui permettre d’être sédaté jusqu’à sa mort, il a choisi d’arrêter ses soins, de boire et de manger. Tout ceci fut extrêmement médiatisé. A bout de souffrances, Cocq a décidé d’accepter les soins palliatifs et a repoussé ensuite sa décision de mourir. Et là il n’y avait plus aucun media s’intéressant à lui. J’aurais aimé savoir si Cocq avait, avant sa décision de mourir, bénéficié de soins palliatifs de qualité et si sa douleur avait convenablement été prise en charge. C’est une chose de vouloir mourir, c’en est une autre que de le vouloir parce que la médecine ne gère pas vos douleurs alors qu’elle peut le faire.
Lorsque j’ai dit sur twitter que ma mère avait un cancer du pancréas, plusieurs soignant-e-s sont venu-e-s me dire en DM de surveiller que sa douleur était bien gérée. Or, je savais, car beaucoup de médecins me l’avaient également dit, que nous savons contrôler la douleur des malades en fin de vie et ce, jusqu’à un stade très avancé ; nous avons les médicaments pour et nous savons les utiliser. On sait donc contrôler la douleur mais c’est donc visiblement peu et mal fait.
Ce texte se veut donc, aussi, un plaidoyer pour les soins palliatifs, termes qui font peur parce qu’ils impliquent une mort plus que certaine (on peut toujours avoir un doute) , une agonie avec une perte d’autonomie (et dans un monde validiste rien ne fait plus peur) accompagnée de douleurs d’intensités variables.
Je vais parler de validisme dans ce texte. Je vous renvoie au site du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation et son manifeste qui parle ainsi du validisme : « Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Il associe automatiquement la bonne santé et/ou l’absence de handicap à des valeurs positives telles que la liberté, la chance, l’épanouissement, le bonheur, la perfection physique, la beauté. Par opposition, il assimile systématiquement le handicap et/ou la maladie à une triste et misérable condition, marquée entre autre par la limitation et la dépendance, la malchance, la souffrance physique et morale, la difformité et la laideur. »
Même si nous souhaiterions tous et toutes mourir d’un infarctus dans notre sommeil, nous serons beaucoup à mourir comme ma mère, dans la souffrance psychique et physique. Et nous serons peu à nous suicider avant. Autant donc que les soins qu’on nous apportera à ce moment là soient les plus adaptés possibles.
Lorsque j’ai cherché à me documenter sur la fin de vie, j’ai été frappée du nombre de gens dont les proches étaient morts dans des souffrances extrêmes sans qu’ils remettent en cause cette souffrance. Beaucoup demandaient la légalisation de l’euthanasie sans pour autant demander, également, l’universalisation des soins palliatifs et une meilleure prise en charge de la douleur.
Ma mère et moi (nous n’avons pas d’autre famille) avons appris qu’elle avait un cancer du pancréas en septembre 2019. Ce cancer a un des pronostics les plus sombres ; 5 ans après l’annonce du diagnostic, tous stades confondus, seulement 7 à 9% des malades sont encore en vie. Ma mère avait 77 ans et un cancer très avancé.
Dans ces cas-là, la médecine ne prétend pas guérir le malade. On lui propose directement des soins palliatifs. On espère stopper la progression du cancer pendant un moment tout en offrant au malade la meilleure qualité de vie possible. Ma mère a ainsi fait une chimiothérapie palliative ; elle ne prétend pas faire disparaitre la tumeur, mais ralentir sa progression.
Quelqu’un m’a écrit que perdre sa mère était la chose la plus douloureuse (si évidemment on l’aime), je prétends pour ma part avoir fait l’expérience d’une successions de deuils, parfois définitifs, d’autres temporaires. L’absence n’est pas, tout au moins pour moi, la chose la plus difficile à gérer.
Evidemment ici je ne vais parler que de moi. Il ne vous aura pas échappé que ma mère est morte donc il est difficile de la faire parler. Le texte paraitra sans doute d’un grand égoïsme aux personnes malades qui le liront ; il l’est sans aucun doute, je le confesse volontiers.
1. Faire le deuil de son validisme.
Si on reprend la définition du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation en l’appliquant au cancer, il s’agit d’accepter que le malade est seul apte à juger si sa qualité de vie est bonne.
Ma mère m’avait dit au début de sa maladie, qu’elle se suiciderait, ayant vu les ravages du cancer du pancréas chez un de ses amis. Elle ne supporterait pas la douleur mais surtout la perte d’autonomie, me disait-elle. Force est de constater qu’elle s’est adaptée et qu’elle n’a pas vécu cela comme une « perte de dignité », expression validiste qu’on ne cesse de nous seriner face aux malades.
En octobre 2019, à cause du cancer, ma mère a développé un abcès au foie, avec des bactéries très résistantes, qui a dégénéré en septicémie. Son pronostic vital était alors très mauvais. Elle s’est beaucoup affaiblie, ne me reconnaissait plus, perdait le contrôle de certaines fonctions, n’avait plus de pudeur. C’est un moment où j’ai voulu qu’elle meure, « pour elle » me disais-je. Avec le recul, je suis capable de mesurer que c’était surtout pour moi, car je ne supportais pas de la voir dans cet état. C’est là qu’intervient la notion de validisme ; voir la condition physique (et surtout mentale) de quelqu’un changer est difficile mais il convient de ne pas calquer notre propre état de santé sur celui du malade en jugeant que sa vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Ma mère n’a pas conservé de souvenirs de cette période et je dois bien admettre que j’ai du travailler sur moi : accepter que oui, la maladie, ferait peu à peu perdre son autonomie à ma mère. Et alors ? Si elle le vivait bien – et l’entourage – moi – a une part à mon sens importante là-dedans, quelle importance.
15 jours avant sa mort, ma mère ne mangeait plus du tout, elle dormait 20heures par jour d’un mauvais sommeil, elle ne lisait plus ni ne regardait la télé, elle était très défoncée par la morphine et autres. Et pourtant elle m’a plusieurs fois dit « avoir honte mais être heureuse ». Elle était heureuse de mourir chez elle (elle avait peur que je refuse parce que mourir chez elle impliquait que je sois là 24 heures sur 24), la fenêtre ouverte sur son jardin. Heureuse parce qu’elle avait réussi à, à peu près, s’apaiser. Là encore, j’avais plusieurs fois (intérieurement bien sûr) remis en cause l’intérêt de continuer à vivre dans de telles conditions. J’en parle parce qu’il est difficile de voir l’état de quelqu’un se dégrader ; c’est un deuil à faire qui est difficile. Mais si nos sociétés étaient moins validistes, si nous ne voyons pas la dépendance, la perte de contrôle (ex l’incontinence) comme intolérables alors tout cela serait moins mal vécu et par le malade et par sa famille.
Je parle de deuils temporaires car la maladie ne laisse pas de répit. En mai, l’infirmier de ma mère m’appelle car il l’a trouvée dans un très sale état. Je descends donc en plein confinement et je trouve ma mère avec tous les signes d’un AVC (salade de mots, incapacité à répondre à des questions simples, caractère changé etc). Je me souviens rentrer chez elle, dans un Lyon vide – on était en plein confinement – et me dire que ma mère était morte puisque son esprit n’était plus là. J’avais une autre personne en face de moi, totalement différente. Et puis au bout de deux jours, les choses sont à peu près revenues à la normale ; ce n’était pas un AVC mais des séquelles d’une septicémie massive.
Je parle de deuils temporaires car la maladie vous donne l’impression que le malade va mourir dans les jours qui viennent et puis il y a les périodes de rémission où vous vous mettez à lire sur les trois cas mondiaux de miraculés de cancers du pancréas en vous disant que votre mère sera peut-être le quatrième.
Ce qui est difficile à vivre, je crois, c’est de voir combien le malade change mentalement. La dernière semaine de sa vie, ma mère a vu sa dose de morphine doublée par le médecin qui l’a sans doute un peu surdosée, aurait peut-être dû faire des paliers, mais on était en fin de vie et on ne pouvait pas prendre le risque qu’elle ait mal (les douleurs du cancer du pancréas sont extrêmement intenses). Je me suis rendue compte à ce moment-là que je devais dire une nouvelle fois adieu à un morceau de ma mère, la morphine la changeant beaucoup.
Oui il est difficile de voir une personne changer, perdre le contrôle de certaines fonctions, voir son cerveau battre la campagne mais si nous vivions dans une société moins régie par la performance, par l’idée que toute défaillance corporelle est sale, laide et honteuse, nous (malades et proches) le vivrions à mon sens différemment.
2. Faire le deuil de ses certitudes.
On lit souvent des pamphlets contre les médecins et l’acharnement thérapeutique ; mais où commence-t-il ?
J’ai été bannie de twitter parce que j’ai souhaité un cancer (ok c’était très con je l’admets) à un type se prétendant soignant qui me disait qu’il était de l’ordre de l’acharnement thérapeutique que de faire faire une chimio à ma mère. Je ne saurais dire si la chimio a permis à ma mère de mourir moins vite. Je sais en revanche dire qu’elle a souhaité cette chimio même si elle a été difficile. Je sais en revanche qu’elle a dit aux médecins qu’il fallait « tout tenter » pour lui donner un peu de temps et je sais aussi que les médecins ont parfois du mal à lâcher un patient parce que c’est difficile de se dire qu’on ne gagnera pas cette fois-ci.
Peut-être à la fin de sa vie, qu’il aurait fallu arrêter certains traitements plus précocement. Parce que tout traitement a des effets secondaires qu’il faut pallier par d’autres traitements, qui eux-mêmes en ont également. Peut-être a-t-on poussé trop loin. Peut-être aurait-on du sédater 24 heures plus tôt.
Mais je n’ai là-dessus aucune certitude parce qu’il est difficile de savoir ce qui est bon pour le malade et non pas pour soi.
3 jours avant de mourir, ma mère a développé une encéphalopathie hépatique. C’était prévu et les produits de sédation étaient prêts (pour expliquer. La loi Leonetti permet, si le patient est sur le point de mourir et que ses douleurs ne peuvent être soulagées, de le sédater profondément). Ma mère avait rédigé ses dernières volontés en demandant à être sédatée dans trois conditions :
- si la morphine n’était plus efficace face aux douleurs physiques
- si les anxiolytiques n’étaient plus efficaces face aux angoisses
- si elle était en insuffisance respiratoire
Un matin ma mère s’est réveillée dans un état de terreur absolue. J’ai déjà fait des crises de panique, j’ai déjà vu des gens faire des crises de panique ou d’angoisse majeures ; imaginez cela, multipliez-les par 1000 et vous aurez une vague idée de l’état de ma mère. Elle hurlait, pleurait. Malheureusement ses tout derniers mots auront été « aide moi » et le fait est que je ne pouvais pas l’aider, sinon à appeler l’infirmière pour qu’elle arrive au plus vite.
J’ai fait pression pour qu’elle soit sédatée en indiquant bien que les angoisses étaient majeures (j’ai appris ensuite en faisant mes recherches que l’encéphalopathie hépatique pouvait causer des terreurs, des hallucinations). Ma mère étant hospitalisée a domicile et son oncologue étant à 100 km, les décisions se prenaient par téléphone. J’ai donc dû insister une nouvelle fois pour que les doses d’hypnovel soient augmentées car lorsque nous bougions ma mère elle se mettait à hurler, à pleurer, à crier « non » tellement elle avait apparemment peur de tomber.
Je dois faire le deuil de cette décision. J’aurais aimé retarder la sédation espérant que le cerveau de ma mère revienne 5 minutes et que, comme dans les films, on se dise adieu et où elle me donne des conseils à la con sur comment mener ma vie. Même une de ses phrases de droite, j’étais preneuse.
J’aurais aimé accélérer la sédation car je m’en veux de cette matinée ou elle s’est réveillée terrorisée et je me dis que si j’avais emmerdé mon monde la veille, elle aurait été sédatée plus tôt. Il n’y a pas de bonne décision dans de tels cas et c’est difficile à admettre surtout pour quelqu’un comme moi qui aime ce qui est manichéen et binaire.
Et je comprends les médecins qui ont du mal à se dire que c’est terminé, qu’ils veulent tenter encore un truc, qui veulent soulager en entrainant des réactions en chaine difficiles à prévoir.
3. Faire le deuil de la rationalité
J’ai lu plusieurs fois de sérieuses engueulades sur le fait de dire ou pas la vérité aux malades.
Ma mère a appris en avril qu’elle avait des métastases osseuses ; ce n’est pas une réalité qu’elle a pu intégrer et elle me parlait de « son arthrose ». Fin mai, elle a pu prononcer les mots et ses métastases osseuses sont devenues pour elle une réalité avec laquelle elle pouvait vivre.
Il est difficile dans ces cas-là de réinsister ; « non tu ne dois pas faire d’effort sollicitant ton dos à cause des métastases ». « tu as très mal à cause des métastases donc oui il est logique qu’on augmente ta morphine ». Une fois que la vérité est dite, il est difficile de réinsister si le malade ne peut pas/ne veut pas l’entendre. Chacun-e son rythme.
Une heure après avoir appris que c’était désormais une question de jours, ma mère m’a demandé ce que je voulais à Noël avec une tournure de phrase laissant entendre qu’elle serait là. Ce n’était pas du déni, simplement son cerveau lui a laissé un moment de répit bienvenu.
J’ai évidemment dit ce que je voulais à Noël parce que mentir était nécessaire et utile.
Bien malin est celui ou celle qui sait qu'il ne faut pas mentir.
4. Faire le deuil des traumatismes
C’est la partie que j’ai le plus hésité à écrire car c’est peut-être la chose la plus impudique que j’aurais jamais écrite. J’ai l’impression de transgresser un grand tabou en le faisant.
J’ai souhaité lorsque j’ai appris que ma mère allait mourir, m’y préparer (quelle prétention). J’ai ainsi appris l’existence des râles agoniques, qui me terrorisaient. Ils définissent la phase (si j’ai bien compris) où le malade est désormais trop faible pour tousser. Les secrétions s’accumulent au fond de sa gorge, l’air passe au milieu et cela produit un râle. Il n’est pas douloureux pour le malade mais très difficile à entendre pour l’entourage. Certaines études prétendent d’ailleurs que le médicament administré pour tenter de faire passer les sécrétions est surtout intéressant pour la santé psychique de l’entourage, bien plus que pour le malade.
Trois jours avant de mourir, ma mère a commencé à avoir un comportement étrange, que j’ai mis sur le dos de la morphine ; la dose ayant été plus que doublée, il était logique qu’elle soit très HS. Elle a eu quelques hallucinations mais la morphine peut en provoquer. Un soir elle a commencé à refuser l’oxygène, avec une voix de petite fille, elle voulait absolument déambuler dans la maison alors qu’elle en était incapable, je devais donc littéralement la porter d’un endroit à l’autre. L’infirmière est venue en urgence et lui a administré un valium.
elle s’est réveillée à 5 heures du matin en pleine panique avec ces fameux râles agoniques. C’est là que le processus de sédation a été mis en place. Ce qui est assez fou, c’est que je n’ai pas été capable de comprendre ce que c’était alors que j’avais beaucoup lu sur le sujet. Le cerveau humain est curieusement fait.
Ces râles sont indescriptibles, un mélange de toux glaireuse, de ronflement ; ils sont très traumatisants je le confirme (désolée c’est le max que je peux dire là-dessus, je ne sais pas parler de ce que je ressens).
L’hypnovel (le médicament qui sédate) a ensuite été augmenté car visiblement ma mère continuait à être très angoissée. C’est vraiment la chose que je regrette ; qu’aucun soignant ne m’ait dit qu’il y avait un risque de terreurs et d’hallucinations avec une encéphalopathie.
Il y a eu un moment difficile où j’ai du aider l’infirmière à enlever les bagues de ma mère (ses doigts avaient énormément gonflé et cela faisait compression). J’ai eu l’impression de la détrousser ; et de l’autre cela m’a rassurée sur l’efficacité de l’hypnovel car on a vraiment tiré comme des malades sans qu’elle bouge un sourcil.
Le 15 juillet au soir, j’ai eu le sentiment que ma mère allait mourir. Certes comme tous les soirs depuis 8 mois mais ce jour là c’était un peu plus fort. Je l’ai trouvée agitée, le visage crispée, les mains qui bougent spasmodiquement. J’avais l’autorisation de faire des bolus (avec une pompe à médicament, le malade reçoit des médicaments en continu et il peut s’en injecter une dose d’un seul coup ; on appelle cela un bolus) de morphine et hypnovel et c’est ce que j’ai fait. Elle s'est apaisée ; le visage s'est décrispé, les mains sont retombées sur le drap. Malgré cela j'ai su qu'elle allait mourir dans la nuit. Je suis allée dormir, ce que je n'ai pas réussi à faire.
Le lendemain elle était morte. J’ai débranché la pompe à oxygène. Il y a quelque chose que je trouve très bien dans la religion musulmane (peut-être que cela existe dans les autres monothéismes je ne sais pas) c’est la place accordée à la toilette mortuaire ; je pense que cela permet de pleinement réaliser les choses. Sans vouloir faire sa toilette, j’aurais voulu enlever les tuyaux qu’elle avait de partout, cela m’aurait donné l’impression de mettre un point final. Malheureusement les infirmières n’ont pas voulu.
Et voilà l’histoire s’arrête ici.
Si je devais tirer quelques conclusions de cette expérience :
- lire beaucoup et davantage les militant-e-s qui nous informent sur le validisme
- un rapport est paru sur les soins palliatifs ; faire le même rapport côté malades
- comprendre pourquoi la douleur est si mal prise en charge alors qu’on sait le faire ; on sait déjà par les militant-e-s qu’il y a des raisons sexistes/racistes à certaines non prises en charge.
Dans le cas de ma mère il y a sans nul doute un manque d’écoute (du à plein de choses). Lorsque ma mère leur disait que « ca allait » et que je creusais, je découvrais qu’elle était à 5 de douleur. Parce qu’elle ne voulait pas « emmerder les gens », parce qu’elle avait « l’impression de devenir douillette » , parce qu’elle « avait peur que si elle prenait trop de calmants maintenant ils n’agissent plus ensuite ».
- ne pas minorer les angoisses. J’ai demandé et insisté à ce que ma mère soit sédatée à cause de ses terreurs ; les soignant-e-s avaient ses dernières volontés sous le nez mais ils avaient zappé le passage sur les angoisses.

Il y a quelques temps j'ai écrit cet article sur la difficulté à voir vieillir les femmes. Je me suis dit que c'était un petit geste militant de poster cette photo de ma mère, trois semaines avant sa mort. Le cancer lui a pris sa graisse et ses muscles. Ses pupilles sont dilatées à cause de la morphine, symbolisée par le petit sac bleu qui lui en délivre. La maladie l'empêche de boire du vin, elle a donc une menthe à l'eau. Elle essaie de cacher la pompe à morphine avec un foulard qui a bougé, et l'autre foulard essaie de dissimuler ses cheveux trop longs. A côté d'elle, son déambulateur. C'est à la fois elle et plus tout à fait elle. La maladie vole beaucoup de choses.
merci de m’avoir lue
Marc Dutroux est un électricien belge, qui, en 2004 a été condamné pour « assassinats, de viols sur mineurs, de séquestrations, d'association de malfaiteurs et de trafic de drogue. ». Il a été arrêté en 1996 ; il a été condamné pour avoir assassiné An Marchal et Eefje Lambrecks et violé Henrieta Palusova, les sœurs Manckova, Laetitia Delhez, Sabine Dardenne, An Marchal, Eefje Lambrecks, Julie Lejeune et Melissa Russo. Cette affaire, tant par l’horreur de faits que par l’incurie des services de police et de justice a eu un retentissement international. Dés son arrestation, Dutroux est mythifié et devient Le Pédophile, Le Monstre.
Je me suis souvent demandée pourquoi Dutroux avait incarné ce rôle alors que bien d’autres hommes comme Christian Van Geloven ou Didier Gentil ont commis des actes tout à fait atroces. Il me semble qu’il n’y a pas d’argument rationnel à cela mais on peut en revanche constater combien nos obsessions autour du pédocriminel et assassin Dutroux ont ralenti la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants et les mineur-e-s en général. Rappelons-le une nouvelle fois ; selon l’enquête Virage, 40% des femmes interrogées dans cette enquête et 60% des hommes ont connu les premières violences sexuelles lorsqu’ils avaient moins de 15 ans. A plus de 80% ces violences ont été commises par la famille ou les proches.
Et pourtant année après année, plus de 20 ans après l’arrestation de Dutroux, les hommes qui violent des enfants ont encore dans notre inconscient, son profil et son modus operandi : un homme, frustre, qui enlève des enfants pour les violer dans des conditions atroces et parfois les tuer. Un homme mal inséré socialement, qui vit de petits boulots et de délits divers.
Cette image pratique participe à la culture du viol c’est-à-dire à l’ensemble des idées reçues autour des violeurs, des victimes et des viols eux-mêmes.En définissant Dutroux comme étant l’archétype du violeur d’enfants, de fait nous tendons à montrer que tous ceux qui ne commettent pas des actes de la même gravité que ceux de Dutroux (et bien peu le font) ne sont au fond pas si terribles.
Il ne s’agit pas de comparer ici les actes de Polanski et Dutroux. Même s’il le dit pour de très mauvaises raisons, Finkielkraut a raison de dire que Polanski n’est pas Dutroux. Dans son esprit, cela l’exonère de tout crime. Dans le mien cela signifie simplement que Polanski n’est pas un assassin et qu’il est sans aucun doute capable de s’amender (plus aucune victime n’a rapporté des faits de viol après 1983) ; ca n’empêche pas qu’il ait commis des viols, qu’il n’a pas été condamné pour cela et qu’il se permet des remarques tout à fait déplacées pour le dire gentiment, lorsqu’on lui rappelle ses actes.
Mais ce qui est intéressant c’est de constater combien Polanski a au fond pris la place de Dutroux dans l’esprit du grand public. Je suis modératrice de contenus sur Internet depuis les début des années 2000 ; sans prétendre que les commentaires seraient une source fiable pour jauger l’opinion française, il me semble intéressant de montrer combien ils ont évolué. Il y a encore dix ans, la grande partie de la société française était pro-Polanski en accusant la victime qui a porté plainte de tous les maux. Elle était régulièrement trainée dans la boue, comme sa mère, insultée etc. Et je pourrais très exactement dater le moment où l’opinion publique a commencé à changer, c’est octobre ou novembre 2019 au moment du témoignage de Valentine Monnier. Il ne se passe pourtant rien de très nouveau ; on sait déjà que Polanski a violé Geimer, on a X autres témoignages. Mais celui-ci semble changer la donne ce qui n’a rien de très rationnel au fond.
On pourrait s’en réjouir, mais, vous finissez par me connaitre, je ne peux m’empêcher de m’étonner d’une société si prompte à condamner Polanski (alors qu’il était l’homme à défendre 6 mois avant) alors que, d’un autre côté, l’immense majorité des victimes de viols continuent à dire qu’elles sont mal reçues et soutenues par leur famille, leur ami-e-s, la police etc lorsqu’elles parlent. Et les réseaux sociaux nous montrent chaque jour ce qu’il se passe lorsqu’une victime parle ; elle est là aussi trainée dans la boue. J’étais ainsi très étonnée de voir des hommes, qui en temps normal se contrefoutent des violences sexuelles, voire même sont masculinistes, prendre fait et cause contre Polanski.
Je crois au fond que Polanski joue un rôle d’épouvantail confortable. Rôle que jouera peut-être Matzneff, s’il décide, comme je le crois, de balancer quelques noms dans la presse, pour redevenir l’objet de nos attentions. Je parlais de culture du viol tout à l’heure pour définir les idées reçues entourant les violeurs. Deux idées sont très courantes :
- la première est l’altérisation du violeur ; c’est-à-dire que nous faisons du violeur un être rare, forcément monstrueux, forcément loin ce que nous sommes (si on est un homme), forcément loin des hommes que nous fréquentons (si on est une femme ou un homme). Cette idée aide beaucoup d’hommes à ne jamais s’interroger sur leurs comportements sexuels ; ils savent (cas Dutroux) qu’ils n’ont jamais enlevé des enfants pour les violer à répétition et enfin les tuer. Ils savent (cas Polanski) qu’ils ne sont pas de richissimes réalisateurs avec 9 accusations de viol aux fesses. Et c’est, à mon sens, tout l’écueil de #MeToo. S’il est important de parler des violences sexuelles par secteur d’activité pour mettre en place des bonnes pratiques dans ces secteurs, cela contribue aussi malheureusement à faire croire, que le problème est circonscrit à un domaine ou que c’est le domaine qui crée le viol. C’est ce qu’on avait par exemple lu au moment de l’affaire DSK, la politique était un milieu difficile, avec beaucoup de stress, ce qui expliquait qu’il ait « craqué » (alors qu’être interimaire à Sodexo c’est une bonne planque tranquille et sans stress). S’il est important de nommer ceux dont on sait qu’ils ont violé, on se heurte là encore à un mur ; nommer des hommes célèbres, médiatiques, sert paradoxalement l’immense majorité des violeur qui, eux, ne sont ni célèbres, médiatiques. Cela leur permet encore une fois de se distancier et de se dire que puisqu’ils ne sont pas comme ces hommes célèbres, alors les viols qu’ils ont commis ne le sont pas non plus.
- la deuxième est le danger extraordinaire à imputer à la célébrité et à la richesse l’impunité donc a pu bénéficier Polanski. Il existe des biais dans la justice et ce quel que soient les crimes et délits commis. En clair il y a plus de pauvres en prison que de riches et cela vaut pour les violences sexuelles. Cela s’explique de différentes façons, les pauvres subissent plus de contrôles (des services sociaux par exemple) ce qui peut permettre de détecter une situation d’inceste. Les pauvres sont moins armés pour se défendre face à la justice. Mais ce biais ne doit pas nous faire oublier que l’immense majorité des victimes ne portent pas plainte, que s’il y a plainte, les deux tiers sont classés sans suite et qu’un procès n’aboutit pas forcément à une condamnation (on se souvient du viol de cette enfant de 11 ans où il y a eu acquittement au premier procès). La réalité est donc toute simple ; l’immense majorité des violeurs s’en tirent sans mal. Pas parce qu’ils sont riches et célèbres mais parce tout simplement par sexisme et misogynie. Nous avons tous et toutes grandi dans une société où l’on nous apprend que les femmes sont fourbes (2000 ans de christianisme où l’un des principaux personnages féminins Eve, fout tout en l’air par ruse, en faisant croquer à Adam la pomme, ca laisse des traces), qu’elles mentent, qu’elles font des histoires pour rien, qu’elles sont hystériques et mal lunées. Les hommes s’en tirent parce qu’une femme ne vaut pas grand-chose. Alors bien sûr il y a des biais racistes ou de classe ; un homme noir qui viole une femme blanche risque davantage la prison qu’un homme blanc. Un homme pauvre risque davantage la prison qu’un homme riche. Mais ne nous y trompons pas, la richesse et la célébrité de Polanski l’ont aidé mais ce n’est pas cela qui a aidé à constituer son impunité. L’immense majorité des personnes violées l’ont été par des hommes qui n’étaient ni riches, ni célèbres et qui s’en sont très bien sortis. Imputer le viol (et son impunité) à la richesse et à la célébrité c’est encore une foi oublier qu’il existe des femmes riches et célèbres et qu’elles ne violent pas. C’est encore une fois procéder à une stratégie d’altérisation pour les hommes qui dénoncent Polanski en leur permettant de ne pas s’interroger sur leurs propres comportements puisqu’ils n’ont de toutes façons rien à voir avec lui. Rappelez-vous que la majorité des victimes ne portent pas plainte parce que nous avons organisé une société où avoir été violée est honteux, où on ne se rend pas toujours compte qu’on l’a été (si on est persuadée que le viol conjugal n’existe pas, on n’ira pas porter plainte si ca nous arrive) et où l’intégrité d’une femme compte moins que le fait de mettre un pauvre homme devant la justice.
Les hommes qui violent, violent parce qu’ils le peuvent. Parce que notre société au-delà d’un discours convenu sur certains types de viols (les plus horribles, ceux qui n’arrivent quasiment jamais) nous berce avec des idées reçues sur les « vrais violeurs », les « bonnes victimes » et ce qu’est un « vrai viol ». Les hommes qui violent violent parce qu’on leur a expliqué dès leur plus jeune âge, que c’est ce qu’on fait quand on est un bonhomme, qu’au fond les filles finissent par aimer ça et que, de toutes façons une fille valant moins qu’un garçon, elle doit se soumettre à ses désirs. Elle compte au fond si peu. Les hommes violent, parce qu’ils se convainquent que ce n’était pas vraiment un viol (« je n’avais pas de couteau ») qu’elle a aimé ça au fond ou qu’elle l’a cherché cette salope. Et ils sont appuyés par ca par toute la société. Relisez, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas féministes ce que vous avez pu dire de Samantha Geimer il y a dix ans, lorsqu’elle n’était pas la parfaite victime à utiliser pour défendre Polanski. Les faits n’ont pas changé mais vous les trouviez curieusement acceptables il y a dix ans. Alors un biais social oui ; oui le plombier est plus jugé et va plus en taule que le notable s’il est accusé de viol. Mais en faire une simple histoire de classe, éviterait encore une fois la question principale ; ce sont les hommes qui violent. Et ils violent parce que nous leur offrons un assentiment tacite, en trouvant dans la majorité des cas des circonstances atténuantes aux violeurs et aggravantes pour les victimes.